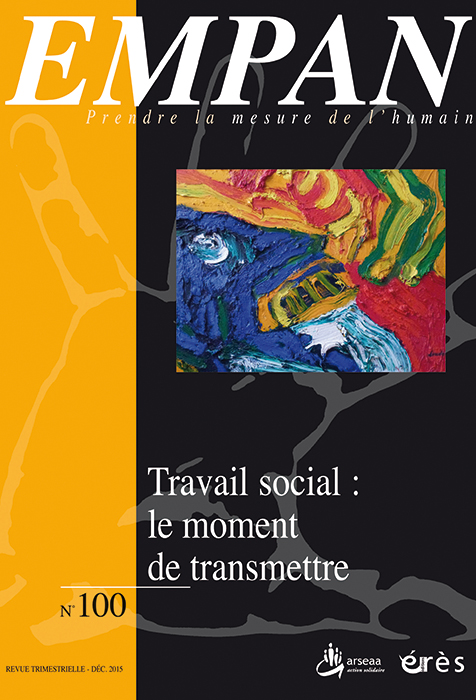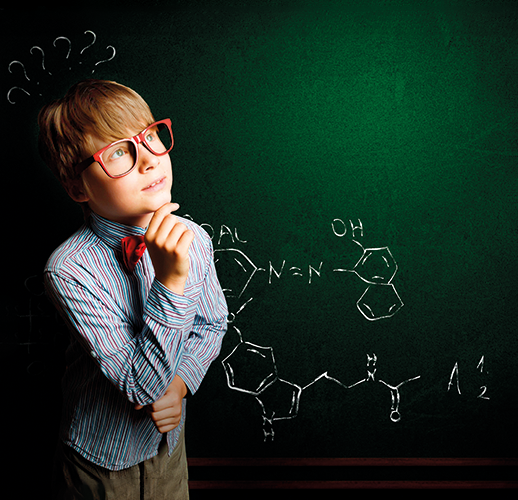Dossier : journal des psychologues n°250
Auteur(s) : Fotso-Djemo Jean-Baptiste
Présentation
La représentation du vieillissement varie d’une génération, d’une culture à une autre. Les nombreux remaniements qui sont en jeu durant cette période de la vie d’un individu appellent à la valorisation du lien culturel et intergénérationnel.
Mots Clés
Détail de l'article
Considérer le vieillissement comme un processus tout autant, sinon davantage, que comme un état, c’est s’ouvrir à l’inter et au transgénérationnel : par la dialectique de la dimension interne et subjective d’un état de fait, pour un individu donné, avec celle de la place désormais acquise ou à acquérir, au sein d’une histoire familiale et sociale dont il est nécessairement traversé, en même temps qu’il la constitue. Plus globalement, c’est envisager la problématique identitaire comme questionnant la place qu’on se donne, eu égard à ses identifications. Lesquelles identifications se trouvent, pour ainsi dire, dans le procès du Même et de l’Autre dont parlait Freud, sur la base d’une partie ou de la totalité de l’autre pris comme modèle. À un double titre : le vieillissement faisant intrinsèquement passer le sujet d’une génération à l’autre ; ce faisant, le plaçant avec d’autres (intrafamiliaux ou extrafamiliaux), dans des rapports intergénérationnels, de différenciation ou de similitude. Obligeant, ici comme ailleurs, à cette double polarité du « être moi-même » et du « être comme tout le monde ». Avec une réalité imposante : la représentation change, d’une génération à une autre, d’une scène culturelle à une autre.
Le discours social tente, comme il peut, de symboliser les étapes de ce processus (1er, 2e, 3e et 4e âges), y compris en mettant en parallèle, voire en compensation, en réparation, les pertes et profits de chacun, les avantages et les inconvénients des passages successifs, dont on sait que les repères chronologiques et les réalités historiques, tout en indiquant le « poids des âges » d’un individu singulier, disent surtout à partir de quels repères le psychique et le social articulent les générations les unes par rapport aux autres. Cette articulation, cette interpénétration des générations (dans des rapports de forces instables, mais toujours conflictuels, voire antagoniques, avec des histoires différentes dont dépend la mémoire collective) conduit le social, dans ses statistiques, à parler du « vieillissement de la population », voire à organiser une politique de la natalité, voire une politique économique, compensatrices, réparatrices de ce « poids des personnes âgées » dans l’ensemble de la population. La natalité comme l’économie (le rapport au travail productif) devenant, dès lors, des symboles fortement investis, de la place occupée par chacun comme par chaque catégorie d’âges. À tel moment, inciter les femmes à faire plus d’enfants ; à tel autre, les inciter à prendre un travail extérieur ; à un autre encore, compter sur la natalité plus forte chez les immigrés, ou en avoir peur, etc.
Nous savons ce que provoque, pour le sujet comme pour son entourage, le passage d’une tranche d’âge à une autre : le « encore un an » s’alternant avec le « déjà un an », l’impatience de l’anniversaire à fêter, voire le drame d’un oubli d’anniversaire, se changeant pour le même ou pour un autre, en anxiété, voire en angoisse. Dans tel espace historique ou géographique, c’est la fierté d’« avancer en âge » et d’exhiber ses 50-60-70-80 ans avec leurs traces, leurs marques ; dans un autre, aux femmes et hommes « d’un certain âge », on ne demande pas leur âge : ce tabou plus ou moins explicite n’est transgressé que s’il s’agit de s’écrier : « dire que j’ai déjà… que vous avez déjà 70… 80… ans, ça ne se voit pas… » ! L’âge qui ne doit pas se voir, au risque de devenir, de paraître, « vieux » ! Alors qu’il est de bon ton de « cesser d’être enfant…, de grandir…, de devenir adulte… », il ne le serait pas de vieillir : une équivalence plus ou moins convenue assimile « prendre de l’âge » et « prendre sa retraite » qui résonne comme « battre en retraite » (la vie étant « un combat », comme on sait). Contradictoirement, sur le plan social, il est de bon ton de se revendiquer d’une lointaine famille (aristocratique, bourgeoise, ouvrière…), ou de la Révolution française, comme on vante les vieilles amitiés entre personnes ou entre peuples. Il est de bon ton de vanter les (vieilles) traditions : idéalisant ce qui a toujours été, par rapport aux nouveautés, pensées comme éphémères.
Il en est de l’individu comme de l’humanité : la mort et ses représentations donnant naissance, donc sens, à la vie, laquelle, dans la même dialectique, contient la mort. Si l’enfant, comme on dit, est « le père de l’homme »(Gesell), ce n’est pas exactement à propos de ce petit être qui, de couches 1er âge aux couches 2e âge, passe de l’enfance à l’âge adulte et de celui-ci à la vieillesse ; pas exactement et exclusivement parce que l’enfance contiendrait toutes les potentialités du développement et de la maturation ; mais aussi et essentiellement parce que c’est de l’enfant qui naîtra de lui, comme d’une société se reproduisant, se régénérant, que l’avenir se situe et situe l’être humain dans une perspective historique : le passé, comme le présent et le futur, se renvoyant ainsi les uns aux autres. Naître pour grandir et donner vie à un autre être que soi (transformations internes révélées, confirmées par une position nouvelle, intra-psychique et sociale, de parent et plus tard de grand-parent), témoignant que c’est l’enfant qui fait d’un homme et d’une femme un père ou une mère, en leur faisant changer de statut, donc de génération. Nous nous attarderons sur trois points : l’état de la personne telle que peuvent le répercuter les examens cliniques, y compris dans leurs dimensions transférentielles ; ce rapport incessant, voire contraignant, de l’identité confrontée aux identifications ; et les signes de transmission qui, de l’intergénérationnel, font du vieillissement le procès du transgénérationnel.
Le vieillissement comme état et comme processus
Relisons à ce propos le grand psychiatre Henri Ey (Manuel de psychiatrie) : « …C’est peut-être une répulsion naturelle de la vieillesse qui motive cette attitude descriptive qui conduit à classer les conduites des personnes âgées dans des inventaires de traits de caractère et de symptômes assortis forcément d’une valeur péjorative… » De deux choses l’une : soit cet inventaire à valeur péjorative correspond à une réalité, y compris liée à un âge réel ; ou bien il varie d’un individu à l’autre, et ne définit donc pas dans l’absolu la vieillesse. Et l’on retrouve alors J. de Ajuriaguerra affirmant qu’« on vieillit comme on a vécu ». Henry Ey continuait ainsi sa réflexion : « La personnalité du vieillard n’est pas un simple “objet d’étude”, un état statique, mais une personnalité fragilisée par la détérioration de ses fonctions physiques et psychiques, sensible aux agressions somatiques ou affectives et cherchant, comme aux autres âges, à maintenir un équilibre toujours précaire avec son environnement… de plus en plus difficile et parfois hostile. On voit que cet “état” est encore un “devenir”… « L’auteur du catalogue des conduites, nécessairement plus jeune (affaire de générations), dans son transfert négatif à l’égard du vieillard, privilégie chez la personne âgée les pertes par rapport aux bénéfices, au gain, ou du moins, par rapport à ce qui se conserve, à ce qui se transforme. Plus de trente ans après Ey, les cliniciens n’ont pas renoncé à ce regard sévère : regard d’identification d’autant plus cruel, quelquefois, qu’il sert à repousser dans un futur lointain, le temps où on lui ressemblerait ; à moins qu’il n’indique le chemin inéluctable dans lequel le sujet s’engage inexorablement. Ce regard veut déjà voir dans la sénescence un état sénile, en tant qu’état déficitaire et pathologique, ce qu’il n’est pas et ne devient pas nécessairement. Ey nous met en garde : chaque âge, le troisième comme l’enfance et l’âge adulte, est recherche d’équilibre ; un état, même à cet âge, est aussi un devenir ; l’environnement joue un grand rôle dans le maintien de cet équilibre « toujours précaire ». Or, cet environnement est également travaillé par le questionnement de son propre vieillissement, donc de sa propre menace de déchéance, de disparition, si « du sang neuf » ne vient pas régénérer « le vieux » : là se loge la question de l’anomie, de la « mortalité sociale », et les problématiques démographiques. Au-delà des statistiques, la dynamique sociale inconsciente et son appareil psychique fonctionnent là comme si, dans le narcissisme de vie et de mort, à l’image de l’enfant venant réparer les parents dans leurs propres désirs œdipiens, le taux de natalité à l’échelle d’un pays fonctionnait comme formation réactionnelle face aux images de dégradation, face aux morbidités, face aux dimensions mortifères du surmoi tyrannique et des pulsions destructrices du social dont témoigne la recherche impossible du bonheur ou de la maîtrise de la nature, comme dirait Freud.
Tel est le sens de l’espérance de vie, variable en fonction du niveau de développement scientifique et technologique d’un pays (dont le développement des sciences en général, et celui de la médecine en particulier), et donc avec le niveau de vie du sujet. Plus élevée dans les pays riches que dans les pays pauvres, elle a augmenté de dix à vingt ans depuis trente, quarante ans, dans un pays comme la France. Permettant ainsi de voir la succession des lignées familiales (dont les grands-parents de quatre-vingts ans, voire les arrière-grands-parents de quatre-vingt-dix ans encore vivants). Pendant qu’avec la misère, les guerres, l’écosystème, les maladies (dont le paludisme, la tuberculose et le sida), cette espérance de vie baisse de plus en plus dans les pays sous-développés : dans beaucoup de pays africains par exemple, ceux en particulier où le taux de prévalence du VIH remonte à 15 %, voire à 35 % de la population, l’âge de cinquante ans devient la moyenne d’âge de vie optimale, avec de plus en plus d’orphelins et de veuves, mais aussi de moins en moins de jeunes pour assurer l’avenir. Partout, il semble exister une inégalité homme-femme, sur ce terrain de l’espérance de vie : les femmes vivant plus longtemps dans les pays développés et moins dans les pays non développés (sans doute un rapport différentiel à la maternité et au travail). Bien que, comme mères et reproductrices, dans toutes les cultures, mais plus particulièrement rurales, elles représentent la fécondité, la Terre, la tradition et l’assurance de la continuité de la famille.
Mais, pour nous en tenir au processus du vieillissement et aux états qu’il crée ou révèle, dont la détérioration des fonctions physiques et psychiques, voici comment Jean Maisondieu (1991) en parlait à son tour, le comparant en amont à l’enfant (« avant l’âge de raison… infans : sans parole…, aimé et entouré parce qu’il représente la vie naissante… ») : « En aval, c’est l’âge de déraison. Trop souvent, le sénescent est frappé de sénilité, il retombe en enfance et son discours ne compte plus. Étiqueté dément, il n’a plus voix au chapitre sous prétexte qu’il a perdu la raison (démentis : sans esprit). Inquiétant parce qu’il représente la vie finissante, repoussant de n’être qu’une caricature d’homo sapiens puisqu’il a perdu ses facultés, il est relégué dans quelque maison de retraite ou autre “gagatorium” sous-équipé où il achève de se détériorer à l’écart en attendant la mort… » Maisondieu observe avec sévérité la culture occidentale : elle « pratique l’apartheid de la vieillesse avec une férocité d’autant plus redoutable qu’elle est (parfaitement ?) inconsciente, y compris chez ceux qui en sont les victimes… À la limite, la mort devient l’apanage des vieux, la vieillesse une maladie mortelle dont on peut (doit) se protéger en restant jeune… » Transfert négatif là aussi qui peut, avec beaucoup de précautions pour une telle hypothèse, signifier le parricide ou le matricide enfin se réalisant : la toute-puissance parentale (supposée ou réelle) aurait ainsi son revers de déchéance physique et mentale préalable à la mort. Citant V. Jankélévitch, Maisondieu peut ainsi ajouter : « […] telle est donc cette irréversible sénescence, dont la sénilité est le terme : d’abord, tout à espérer et rien encore à regretter, et, finalement, tout à regretter et plus rien à espérer… ». Discours qui occulte le religieux, ou tout simplement le spirituel, avec sa dimension de transcendance, la crainte ou l’espoir d’un autre monde. Globalement, il faut avoir travaillé sur son transfert, comme Naomi Feil (1997), pour recommander « une attitude de respect et d’empathie…, aider ces êtres mal orientés à recouvrer leur dignité en se sentant écoutés sans jugement et acceptés dans leur propre vision de la réalité… ».
Pas étonnant que, dans ce qui fait leur perte, ce soit ce qui d’eux faisait envie aux générations d’après, ou ce qui met en valeur ces jeunes générations, qui soit mis en avant : l’abandon des investissements d’objets et la régression au narcissisme font partie des signes les plus cités. « Ce n’est plus de notre âge » vient faire écho à « nous avons vécu…, en notre temps… », pour asseoir plus que la nostalgie de véritables tableaux dépressifs ! D’où les luttes multiformes (Viagra, chirurgie, alimentation, sports…) qui « redonnent une nouvelle jeunesse ». Non pas seulement pour « rester jeune », mais comme pour donner le change aux jeunes eux-mêmes (« je ne suis pas encore fini », semblent-ils dire) : comme si la vie ne pouvait s’envisager que comme compétition pour les mêmes places, les mêmes objets de réalisation de soi. C’est à croire que les troubles de la mémoire, pour la personne âgée, servent en quelque sorte de barrière de protection pour moins souffrir de ce « catalogue de pertes ». Nous savons ce qui s’écrivait sur le vieillard d’Afrique, décrit positivement par l’accumulation de ses expériences, comme un puits de sagesse (sa mort représente, disait le vieux sage Hampaté Bâ, « une bibliothèque qui brûle »). Cette image idéalisée a-t-elle encore un sens aujourd’hui, même s’il n’y a pas (encore) dans ces régions ces lieux de rejet que peuvent représenter les « maisons de retraite » ?
Quoi qu’il en soit, ici et là, pendant que l’individu vieillissant, voire vieux, se fait ainsi exclure et marginaliser, de plus en plus de bibliothèques, de musées, avec tous les moyens sophistiqués de ces dernières années, se développent pour immortaliser les savoirs et souvenirs de l’histoire collective. La conjugalité, la parentalité, le travail, le logement, les valeurs, en sont quelques-uns des signifiants les plus marquants : le travail de deuil et de mémoire, tout en s’adressant à l’inéluctable de ce que Sigmund Freud disait du « sentiment du temps qui s’écoule (comme) sentiment interne de l’écoulement de notre propre vie », concerne aussi tous ces domaines de renoncements à toutes les acquisitions : début ou signe de sagesse, comme les bouddhistes nous l’apprennent depuis des siècles (eux qui sont dans une problématique plus de l’être que de l’avoir) ? Ne plus s’obstiner à avoir (de) la mémoire, pour écrire ses Mémoires et devenir, être enfin, la mémoire d’une famille, d’une tragédie collective ou d’une épopée, faire la paix avec les morts et les honorer. En sorte que, là où refoulement, oubli, et pardon sont parfois salutaires, c’est parfois sur le mode du Mémorial et de la commémoration que se fait le rapport à la mémoire (refus d’oublier).
Le vieillissement et ses problématiques identificatoires
Jean Maisondieu, dans un article déjà cité (« Vieux fous ? »), écrit plus loin dans son texte : « Devenir vieux n’est pas une sinécure, c’est interdit sous peine d’exclusion, c’est très dangereux, c’est mortel… (À cause du coup de vieux qui l’effraie), il se fait horreur et craint de déplaire aux autres. Certains ne s’en remettent pas ; se voyant décrépits, ils se suicident. D’autres, […] derrière les fards et les teintures, restent sans illusions… Au nom du paraître, c’est le reniement de soi par soi qui commence et, avec lui, la démence s’installe à bas bruit… » Ce qu’on observe là, avant tout, c’est un jeu de miroir : le sujet s’observant et le sujet observé sont dans la même dynamique de dévalorisation, de disqualification de soi. Regardons-en la complexité : par le biais des crises successives qui structurent toute vie humaine ; par les redistributions des statuts et rôles en fonction des âges et des positions sociales (la vieillesse annonçant la position d’ancêtre) ; par les identifications qui, dans certaines cultures, peuvent donner à un jeune une position de père, de grand-père, voire d’ancêtre.
C’est en renonçant au développement linéaire de l’individu, pour une approche en termes de cycles et de crises, que l’on peut le mieux comprendre les remaniements à l’œuvre dans la vie de l’individu : ils donnent à chacun des identités multiples (simultanées ou successives). À l’image de la société elle-même, structurée à partir de la dialectique de coexistence dynamique et conflictuelle de trois paramètres essentiels : la différence des sexes ; la différence des générations ; la différence de places sociales et, pour chacun, des différences et des contradictions. Sur le plan individuel, deux arguments immédiats viennent à l’esprit : le psychisme humain dans sa dimension inconsciente ; et le rapport à l’histoire et à sa propre histoire. Dans l’un et l’autre cas, comment ne pas penser au proverbe : « Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme » ? Il faut être déjà assez vieux, pour être père ou mère : y compris pour les parents mineurs. D’ailleurs, soyons attentifs à l’éducation et aux modalités diverses de l’initiation, qui anticipent pour préparer « le futur homme »/« la future femme » à ses statuts et rôles futurs de père et mère : comme si devenir mère biologique, par exemple à vingt-cinq, trente ans, confirmait la mère de trois, cinq ans qu’on était déjà (avec ses jeux de papa – maman et ses jeux avec les poupées, quand elle nourrit, lange…) ; ou confirmait la fille adolescente qui, dans le bouillonnement identitaire de la puberté, se choisit comme fille, par identification à sa mère, c’est-à-dire s’identifiant aux potentialités de la maternité. Pour le garçon comme pour la fille, on comprend mieux en quoi la question œdipienne de l’enfant le situe d’emblée en face des positions parentales tenues par ses parents, lesquels, en devenant père et mère, le sont au regard de leurs propres problématiques respectives. Être parent, en étant le fils ou la fille de quatre autres parents, en même temps qu’on est oncle ou tante, cousin ou cousine, etc. L’adolescence et ses crises (en tant que moment de passage de l’enfance à l’âge adulte) sont l’étape la plus aiguë où le « temps révolu » des grands-parents sert de prétexte pour mettre en danger les parents, intermédiaires en tout point, pris entre continuité et rupture.
La clinique ne démontre-t-elle pas en quoi la conjugalité (lien d’étayage ou lien narcissique, pour schématiser) se situe elle-même dans un rapport transférentiel aux imagos parentales (« comme mon père » ou « comme ma mère », « surtout pas comme mon père, comme ma mère ») ? Avoir des fils ou des filles, et régler des comptes avec ses frères ou ses sœurs ! De ces règlements de comptes avec les objets internes et externes dépendront les modalités de vieillissement : plus globalement, d’une tranche d’âge à l’autre, les crises et les rites de passage qui les accompagnent (fin des études, travail, mariage, 1er enfant, dix ou vingt ans de mariage…) en témoignent. Et ce, d’autant plus que le procès de l’intergénérationnel aura eu pour fonctionnement soit l’intégration des générations les unes aux autres soit la séparation, voire la scission : la configuration familiale peut en effet se faire sur le mode de l’accumulation et de l’identification de tous au Même-fondateur (le feu pater familias romain, l’actuel ancêtre des sociétés traditionnelles africaines) ou sur celui de chacun « faisant ou refaisant sa vie », chacun fondant et refondant indéfiniment une/sa famille. Le départ successif des enfants de la maison familiale, pour « fonder leur propre famille », donne raison au fur et à mesure à cette angoisse du vieillir, de la retraite et de ce moment fatidique où le couple se retrouvera 24 h/24, tout seul, dans une maison déjà enviée par les héritiers pressés d’avoir chacun leur part. La mise en « maison de retraite » et en « gérontologie », en « service des personnes âgées », devient l’antichambre de la tombe : les parents redoutant le moment de la mort qui viendra confirmer la dispersion, le morcellement de ce qui était leur « famille ».
Et si la mort de l’un annonce la mort imminente de l’autre, la relation narcissique très forte du « couple de vieux inséparables » s’appuie sur la réactivation de la « perte » progressive des enfants qui avaient, pourtant, été la justification (religieuse et sociale) de la conjugalité. Là où, sur une autre scène historique et culturelle, la position de parent et de grand-parent, d’arrière-grand-parent, devient objet d’envie : le « je peux enfin mourir maintenant » venant en écho du bonheur et de la jouissance d’avoir une (grande) descendance, et de la savoir autour de soi comme garantie qu’« ils ne me laisseront jamais tomber ». Vieillir devient ainsi accepté, prendre le risque de se voir identifié à l’ancêtre-fondateur, en tant que représentant le plus ancien du nom de famille, pour la survie duquel, sur toutes les scènes culturelles, se déploient tous les subterfuges contre sa disparition. L’angoisse de la mort n’est plus alors affaire subjective d’une mort physique, mais celle plus philosophique et idéologique, plus spirituelle, de l’éventuelle mort d’une lignée : telle est la base de l’alliance, notamment sur le modèle de l’exogamie (voir le tabou de l’inceste et de la dégénérescence, et l’agrandissement de la propriété) ou de l’endogamie (garantir l’indivisibilité des terres et la domination de la lignée paternelle). D’où cette piste qui relie détérioration et identification, lorsque Maisondieu (1991) écrit : « Les déments ne sont pas aussi fous qu’ils en ont l’air ; leur égarement, leurs défaillances de mémoire, l’altération de leur langage, leur gâtisme même, ces graves perturbations qu’ils présentent ne sont pas [que] les conséquences d’une détérioration mentale, elles sont [aussi] l’aboutissement d’une conduite inconsciente mais systématique de destruction de la pensée pour perdre la lucidité face à la mort et au rejet… » Comme s’il s’agissait, dans les amnésies de fixation, et dans les désorientations, d’une politique de l’autruche refusant de continuer à cautionner l’état des lieux, d’une « débandade », d’une rupture toujours plus marquée, des liens familiaux. Ou pour ne pas usurper cette place d’ancêtre, s’il n’y a d’ancêtre que mort.
Vieillissement et transmissions
« Ce que tu as hérité de tes ancêtres, tu dois l’acquérir toi-même afin de le posséder », disait Goethe. Le vieillissement, comme état et comme processus, devient un révélateur du questionnement sur l’héritage, même s’il n’y a pas lieu ici de s’attarder sur les déterminismes biologiques, psychologiques ou socioculturels ? Qu’en est-il des répétitions et des ruptures ? Partons de deux exemples. Une maman de soixante-quinze ans donne depuis peu des signes manifestes de la maladie d’Alzheimer et, dans ces signes, la peur que l’on ait arrêté et emprisonné son dernier fils. Parfois, cette peur devient conviction : dans les deux cas, elle passe du temps à pleurer sur son sort, implorant son entourage de tout faire pour le sauver. Deux éléments objectifs interviennent dans cette « confusion mentale » : elle a suivi les informations faisant état d’arrestations réelles et de menaces d’arrestation concernant des hommes haut placés dans un pays africain et ayant détourné des biens publics ; son fils travaille dans une banque (lieu de transactions), même s’il est à une place où il a peu de chance d’organiser de tels détournements. Ce qui apparaît évident en revanche pour son entourage, sur le plan subjectif, c’est l’identification de ce fils au père de cette maman (son grand-père), puisqu’il en porte le nom : dans certaines cultures africaines en effet, un enfant, loin de porter le nom du père (qui serait le nom de famille, le même pour tous), porte celui d’un grand-père, d’un oncle, d’une tante, du côté paternel, ou du côté maternel. Nom qui l’identifie, par conséquent, à la génération de ses parents, voire de ses ancêtres de l’une ou l’autre lignée : au point où une maman, pour parler, à ou de son fils (même bébé), l’appellera « papa » ; un jeune homme, devenu chef de famille à la mort d’un père socialement haut placé, en porte désormais le nom et se voit appelé « papa », par des oncles et tantes de la génération du père mort, qu’il honorait jusque-là du nom de « père » et de « mère ». Lesquels oncles et tantes, frères et sœurs du père, nommaient celui-ci « père ». Tout cela, sans confusion des générations. Pour en terminer avec la maman et son fils, un élément de l’histoire familiale vient étayer que « les vieux déments ne sont pas aussi fous qu’ils en ont l’air… » et que leur « délire » peut trouver du sens. Deux évènements ont en effet bouleversé la vie de cette femme, à une semaine d’intervalle : le mariage du fils, suivi de la mort de son mari lequel, déjà agonisant à l’annonce du mariage, avait recommandé, au cas où il mourrait avant, de conserver son corps à la morgue, pour faire la fête. Les deux parents eurent donc le bonheur de voir leur fils marié. N’empêche que la coïncidence est là : vie (joie) et mort s’interpellant. Et nous voyons là se profiler une identification entre le mari et le père, par le biais de ce dernier fils, devenu père de deux enfants dont le premier, comme il se doit, porte le nom de son propre père (alors qu’il est, lui, le père symbolique de sa mère). Ascendance et descendance, par le biais des alliances, s’inscrivent ainsi dans une chaîne infinie dont l’hommage aux morts, le culte des ancêtres (croyances, rites et rituels) est le garant. Notons que ce n’est pas ce fils qui a succédé au père mort, mais l’un de ses frères qui portait un nom de la lignée paternelle : en l’occurrence, celui de leur grand-père commun. Le thème du « Père inattaquable » et de « l’Ancêtre inégalable » a souvent fait l’objet de débats (Fotso-Djemo, 1982).
Une autre histoire nous vient d’Anne Ancelin Schützenberger (Aïe mes aïeux), illustrant ce qu’elle nomme « le syndrome d’anniversaire », à travers une relation père-fils très investie : le fils est « un industriel et un homme fort sérieux ». « Son père est un très jeune homme actif de quatre-vingt-neuf ans et qui, on ne sait pas pourquoi, fit une chute dans un escalier roulant, est tombé sur la tête, ne va pas bien du tout, et supplie qu’on le laisse mourir. En quelque sorte, sa vie active est finie… » Que nous apprend l’histoire généalogique ? « Le grand-père est sorti tout seul dans la rue un 26 octobre, il a pris le métro… il a pris l’escalator et il est tombé sur la tête, en dégringolant tout un étage… ; sa femme est morte un 26 octobre, dix ans auparavant… » Là aussi, chaîne identificatoire père-fils et épouse du père. Relation œdipienne, sans doute, mais dans le sens où la question des origines transcende la parenté biologique, pour et par le symbolique. Que prend chacun de l’histoire commune, qu’est-ce qui la fait commune, quelle part laisse-t-on aux autres ? Du coup, c’est de la part appropriée que dépend la place occupée : en sachant que cet héritage est tout autant conscient qu’inconscient, avec ses enjeux économiques, symboliques, psychiques. Enjeux qui expliquent les recherches parfois insensées de paternité, de maternité, qu’il s’agisse des « enfants nés sous X », ou des enfants adoptés ; mais aussi enjeux qui expliquent le mythe familial, le roman familial, avec ses secrets, y compris les délires de filiation.
Du coup, lorsque Nina Canault, par Ancelin Schützenberger, par Didier Dumas, Nicolas Abraham et d’autres interposés, écrit « Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres » (1998), ce ne sont pas les populations africaines croyant aux métempsycoses, et invoquant les transgressions aux lois des ancêtres ou des divinités, dans tous les cas de malheurs, ou les bouddhistes croyant en la réincarnation à travers un nouveau-né, qui seront le plus étonnés. Les « fantômes », les « esprits », les « âmes » dans un cas, les « ombres », les « totems » dans d’autres, sont les métaphores de la permanente activité de l’inter et du transgénérationnel dans l’histoire humaine qui interroge la permanente continuité entre les vivants et les morts : d’où le sens des testaments, des objets hérités (parfois fétichisés, occasion de réactivation des rivalités de places auprès des parents ou grands-parents), ou les « antiquités » des brocanteurs, et d’autres monuments (y compris les cimetières et les tombes).
Conclusion
Histoire en boucle où l’infantile sans âge tient toujours le rôle principal et où ce qui se lit comme « retour en enfance » pour la personne âgée, suscitant attendrissement ou agacement et rejet, renvoie à cette problématique de la prématurité de l’être humain énoncée par Bolk et reprise si justement par Géza Róheim pour mettre en parallèle, voire en équivalence, culture, névrose et enfance prolongée. En tant qu’elles sont traversées par la problématique de la dépendance, et donc des liens nécessaires, pour l’hominisation, voire l’humanisation sans cesse recommencée. Le bébé, dont les pulsions sexuelles s’étayent sur les pulsions d’autoconservation assurées par les adultes, préfigure la personne âgée qui, à son tour, aura besoin pour sa survie, biologique, narcissique, sociale, des liens fondés avec et par ses descendants. Róheim dit que la culture, comme fait culturel, est ce qui vient en suppléance de l’immaturité de l’être humain. La personne âgée, dans l’imminence de sa disparition, vient à son tour rappeler la fragilité du fait culturel, lorsqu’il ne se fonde pas sur le transgénérationnel comme lien symbolique : la culture ne saurait se penser comme : « Après moi le déluge. » La clinique, au-delà des recherches généalogiques qui deviennent un véritable fait de société, découvre avec bonheur, mais aussi avec frayeur « le retour de l’archaïque », « les transmissions de traumas » sur plusieurs générations, empruntant, pour ce faire, à des spiritualités très diverses (énergétisme asiatique, chamanisme mexicain, transe vodù…). Rencontre entre les « vieux mondes » et les « nouveaux mondes ». ■