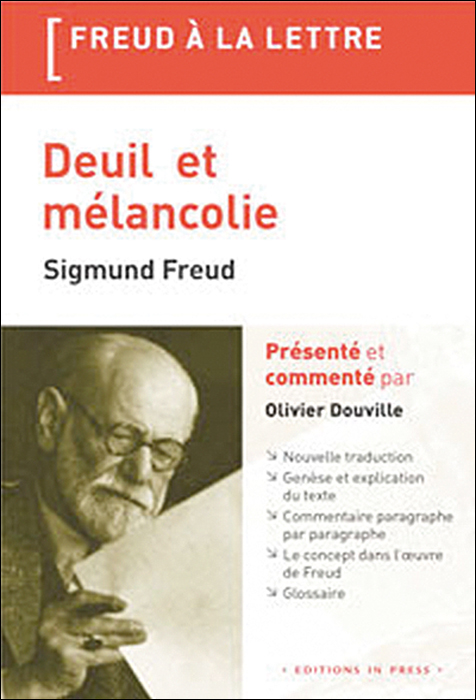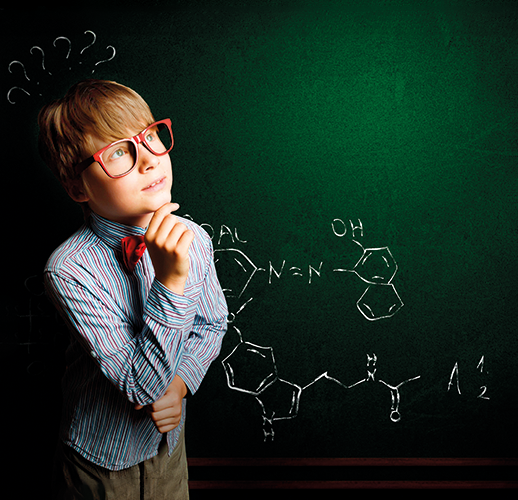Dossier : journal des psychologues n°250
Auteur(s) : Quaderi André
Présentation
Malgré les écueils liés à la perte de mémoire, progressive et irréversible, le dément maintient un processus de pensée, friable mais présent. Si l’on postule que ses rappels verbaux compulsifs masquent en réalité une quête de sens et qu’ils ne se produisent que si une parole subjectivante est présente, quels sont, alors, les moyens dont disposent le praticien ou tout autre soignant pour bâtir un pont langagier ?
Mots Clés
Détail de l'article
La recherche psychologique en gérontologie s’inscrit dans un champ pluriel (développement, cognition, social et psychopathologique) rendant complexe toute approche de son objet. De cette pluralité, un champ original peut se décliner autour des troubles de la mémoire. En effet, la personne ayant plus de quatre-vingts ans en présente fréquemment une altération. Nous nous attacherons plus particulièrement, ici, à l’étude de la mémoire dans le processus démentiel.
Le travail psychique du dément bute sur des écueils, l’obligeant compulsivement à abandonner les voies communes de la parole et du discours. La nature singulière de ces écueils réside dans la perte de mémoire imputable à la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, dont l’Organisation mondiale de la santé dans sa définition de la démence (identique à celle du DSM-IV [American Psychiatric Association, 1996, p. 159]) donne comme définition : « Altération progressive de la mémoire et de l’idéation suffisamment marquée pour handicaper depuis au moins six mois, et d’un trouble d’au moins une des fonctions suivantes : calcul, jugement, altération de la pensée abstraite, praxies, gnosies ou modification de la personnalité. »
Ainsi, compter, rire, analyser, agir, reconnaître, se souvenir (processus naturels et automatiques pour tout un chacun), dégénèrent, au décours de la maladie, en des opérations complexes et impossibles. Ces effets irréversibles et progressifs détruisent les fondements mêmes de la psyché. La personne malade ne se souvient plus de qui elle est, qui sont ses proches, ses enfants, son ou sa conjointe. Véritable tragédie humaine, cette maladie inéluctable conduit à une dégénérescence complète et à la mort. Ainsi, la pensée du dément demeure doublement obscure, à la fois à ceux qui tentent de la comprendre et à lui-même. De ce drame existentiel, nous pouvons tenter ici d’en saisir un sens.
Tout comme P. Aulagnier (1975, p. 17) concernant la psychose, nous sommes portés à reconnaître ce que le modèle analytique laisse hors champ, en remettant en chantier la conceptualisation sans a priori ni préjugé. Peut-être alors tirerions-nous bénéfice du projet d’écouter le dément dans ses démêlés avec la mémoire et ses souvenirs, de ne pas envisager ses pertes et ses ratés sur le seul registre du déficit cognitif, questionnant ainsi le référentiel analytique moins dans ses concepts que dans sa méthode.
La clinique de ce type de pathologie signe de façon incontestable la persistance d’une vie psychique, d’un processus de pensée défaillant mais survivant, tout comme une organisation psychique. Ainsi la structure psychique, même si elle éprouve des difficultés d’adaptabilité (notamment au niveau du principe de réalité), « travaille », tout comme le signifie
J.-M. Talpin (2005, p. 15) dans son étude sur le travail de structure à l’épreuve du vieillissement. Comment alors appréhender la mémoire dans cette clinique difficile ?
Clinique démentielle
Nous rendons visite à Mme R. en service de psychiatrie après son départ de l’institution où nous travaillons. Nous la trouvons assise dans la salle à manger, tassée par une myriade de neuroleptiques. En nous installant près d’elle, nous notons, avec effroi, une absence inhabituelle de réaction ainsi qu’une majoration de ses difficultés d’élocution. Nous nous présentons en évoquant notre parcours commun (sorties, chants, activités diverses, entretiens (1) et, à notre étonnement, nous l’entendons dire, au fil de nos énonciations : « Oh ben ça alors, c’est une surprise, cela me fait plaisir de te voir, je me souviens de toi, tu es mon fiancé et mon amour, je ne peux vivre sans toi. » Durant les quelques semaines avant de mourir, Mme R. ne verbalisait plus que ces quelques mots, répétant compulsivement une demande en mariage et des reproches comme quoi nous ne nous occupions plus assez d’elle.
Mme Porte, quant à elle, hurle régulièrement, telle une corne de brume et un phare obscurci du service de gériatrie. En entrant dans sa chambre, appelés par ses cris, nous verbalisons calmement notre désir de l’écouter, avec des gestes apaisants. Nos paroles tentent de créer un lien en interprétant ses cris, son désarroi, sa souffrance. Au fil de nos paroles, Mme Porte s’y associe en verbalisant ses souvenirs certes confus, parcellaires et surtout extrêmement répétitifs : « L’église, les O…, ça fait long, retourner à pied… » ou encore : « Les bêtes, les chèvres… » Ces souvenirs persisteront, tout comme pour Mme R., dans une même alternance d’agitation et retour au calme par nos propos.
Nous considérons les productions de ces patientes comme des souvenirs, traces mémorielles d’un passé. À ce titre, attribuer à ces mots ce statut ne disconvient pas, même si cela demeure fragile. Les verbalisations, dans ces deux cas, peuvent être comprises comme les manifestations de la double altération mémorielle et des processus idéatoires. Toutefois, une contingence dans l’apparition des souvenirs du dément peut être soulignée. Le dément ne se souvient pas tout seul, la présence d’un autre semble s’imposer pour qu’un souvenir (aussi mince et fragile soit-il) puisse se manifester. Conjointement à l’agitation du dément et à la présence du clinicien, les souvenirs dépendent du contexte énonciatif dans lequel ils se produisent. Comment alors articuler cette clinique à une approche freudienne de la mémoire et du souvenir ?
Le statut de la mémoire dans la théorie freudienne
La théorisation de S. Freud de la mémoire s’appuie essentiellement sur quatre articles majeurs : « Sur le mécanisme psychique de l’oubli » (1898), « Sur les souvenirs-écrans » (1899), « Remémoration, répétition, perlaboration » (1914), « Un trouble de mémoire sur l’Acropole, Lettre à Romain Rolland » (1938). Dans ces articles, Freud n’isole pas la mémoire de son rappel ni l’évocation du souvenir de son contexte (Freud S., 1898, 1984, op. cité, p. 101). Ainsi, dans l’article « Sur le mécanisme psychique de l’oubli », Freud situe la production du mot « signorelli » dans une scène à deux personnages, son interlocuteur et lui-même, auxquels se surajoute la figure de son ami médecin. Freud décrit un oubli bénin où le mot (le manque demeure ici conscient) se dévoile à la formulation. À ce manque se substitue une construction inconsciente (ici en rapport avec le contexte même de l’oubli), « signorelli », signifiant par là le conflit psychique en jeu dans le rappel impossible du peintre d’Orvieto. En ce sens, signorelli s’analyse comme une formation de l’inconscient au même titre que le néologisme et l’acte manqué. L’oubli de mot, l’agitation afférente, l’énervement de la non-maîtrise du mot, Freud les décrit comme : « une pénible et évidente agitation […] accompagne alors les efforts successifs pour trouver le nom dont on a le sentiment qu’on aurait pu en disposer il y a encore un moment » (ibid., p. 99). Cette agitation devant l’oubli du mot, cette effervescence émotionnelle quand le mot se refuse à nous, convergent avec l’inquiétude comportementale du dément évoquée avec Mmes R. et Porte. Nous pouvons donc affirmer sans réserve que les effets de la perte demeurent communs, tant pour le sujet dément que pour celui qui souffre d’une perte passagère. Freud comprend cette tension comme l’appendice visible d’un conflit inconscient de pensées refoulées. En effet, Freud, dans l’incapacité de nommer le peintre (Signorelli) dont il évoque l’œuvre à son interlocuteur, convoque à sa place les noms de Boticcelli et Boltraffio. Si Freud en appelant sa mémoire ne retrouve pas le nom du peintre, il obtient en revanche « tous les détails de la journée passée à Orvieto ». Par le rappel précis de la journée de vacances, Freud souligne moins ici l’échec de la mémoire que le refoulement de représentations. La mémoire, selon la théorie freudienne, s’avère alors une construction inconsciente, entre le processus de refoulement et le retour du refoulé : « le processus (du souvenir) que nous rencontrons ici : conflit, refoulement, substitution avec formation de compromis, revient dans tous les symptômes psychonévrotiques » (Freud S., 1899, op. cité, p. 118). Les fondations de notre mémoire reposent sur des mécanismes inconscients et nos souvenirs se transforment au même titre que l’acte manqué, le lapsus et le rêve pour apparaître à la conscience. Freud, dans « Un trouble de la mémoire sur l’Acropole », le souligne clairement au sujet « d’un énoncé erroné sur le passé » dont il analyse la constitution comme « aussi anormale que les rêves » (Freud S., 1936, op. cité, p. 227). La mémoire s’analyse dans un rapport étroit avec l’oubli qui participe à la formation de souvenir. Ainsi, l’oubli se comprend comme consubstantiel de la mémoire. « L’oublié n’est pas effacé, mais seulement “refoulé” ; ses traces mnésiques existent dans toute leur fraîcheur, mais isolées par des “contre-investissements”, confirme Freud (1939, p. 189) dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste. L’oubli pour Freud « consiste surtout en une suppression des liens entre idées, une méconnaissance des conclusions à tirer et une isolation de certains souvenirs » (Freud S., 1914, op. cité, p. 107). Pour se souvenir, l’oubli et la mémoire fonctionnent conjointement, une dépendance dangereuse pour la véracité du souvenir propice à toute reconstruction inconsciente. Le sujet se trouve alors, pour se souvenir, et comme le souligne Roland Gori (1996, p. 152), « à jamais endetté de son passé sans pouvoir s’en acquitter une fois pour toutes ». Sans cette dette, cette dépendance à la parole, le sujet demeurerait « sidéré par le traumatisme, voué à sa pure et simple répétition. » Ainsi les réitérations compulsives de Mmes R. et Porte s’analysent moins à l’orée des déficits que dans l’absence contextuelle d’une parole subjectivante. Le passé le hante, l’habite et lui échappe. La fonction du souvenir renvoie en réalité à une homéostasie fantasmatique du sujet dont le dément se trouve dépourvu. C’est donc moins la fonction cognitive de la mémoire qui provoque cette compulsivité et plus son incapacité d’être. Le dément souffre en réalité de son incapacité d’oublier qu’il ne peut plus oublier de se souvenir. Dans la relation clinique, nous sommes les témoins impuissants des tentatives désespérées de se souvenir de ce qu’il doit oublier, de se défaire. Le dément par l’altération de sa mémoire et de sa pensée ne peut plus s’acquitter de sa dette à son passé, de cette nécessaire duperie de la parole et de ses réaménagements illusoires. Les rappels répétitifs de souvenirs de Mmes R. et Porte d’une part et l’acuité de l’analyse freudienne de la mémoire, d’autre part, questionnent les altérations dans la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
L’oubli démentiel de la mémoire
Pour le patient atteint de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, l’ensemble de sa vie s’émerge dans la perte de mémoire (pris ici au sens commun). Comment alors comprendre, à partir de Freud, les manifestations dans la clinique du dément, de souvenirs tronqués répétés à l’identique (et parfois à l’infini), sous les affects d’angoisse, d’agitations de Mmes R. et Porte ?
Paradoxalement, Freud nous ouvre la voie dans son article « Remémoration, répétition, perlaboration ». Il présente, à la fin de son exposé, une patiente comme « un exemple extrême ». Cette « dame âgée » « au cours d’états confusionnels avait à plusieurs fois abandonné le domicile conjugal pour fuir quelque part, sans pouvoir motiver cette fugue. Elle commença sa cure chez moi sous le signe d’un transfert positif bien marqué qui crût avec une rapidité anormale dès les premiers jours du traitement. À la fin de la semaine, la dame prit la fuite, avant même que j’aie eu le temps de lui dire quelque chose qui aurait pu prévenir cette répétition » (Freud S., 1914, op. cité, p. 111). Cette dame âgée présente des signes confusionnels s’apparentant, selon nous, à la démence. La répétition des fugues (sans élaboration), l’âge (encore que « dame âgée » à l’époque de Freud ne revête pas la même signification actuelle) s’assimile grandement avec la répétition compulsive dans la maladie d’Alzheimer.
Comment expliquer ces répétitions (Mmes R. et Porte par exemple) qui sidèrent le dément dans une compulsivité de ses actes ? Ces répétitions ne peuvent être comprises si nous omettons de notre analyse l’énervement et l’agitation de Freud devant sa difficulté à verbaliser le nom de Signorelli. Énervement et agitation, mécontentement de soi et libération d’une contrainte expriment à la fois un déplaisir devant la force de résistance du refoulement et le manque que dévoile le mot dérobé. Tout comme Freud devant l’érudit le délivrant de son oubli, le dément, avec un coefficient majoré, se tend vers son interlocuteur dans une intention de parler, de rembourser sa dette. Si Freud ne trouve pas le nom du peintre, sa psyché fonctionne, elle présente un raté isolé, momentané, en résumé, non pathologique. En revanche, pour le dément, le raté demeure, croît et envahit l’ensemble des processus psychiques. Pour Freud, la mémoire se dérobe, dans la démence, elle manque à l’appel, elle va créer par là même un manque à être. Le dément ne peut ainsi que reproduire inlassablement sa demande dans la formulation de souvenirs répétés et partiels. La sidération du manque de mot, directement imputable au processus dégénératif, conduit le patient à un impossible à créer. Roland Gori attelle la dette du sujet à la parole (dette contractée pour se souvenir) à la condamnation « à créer sans cesse » (1996, op. cité, p. 152), à engendrer à l’infini des discours. Pour le dément, son incapacité de se souvenir au sens freudien apparaîtrait liée à la fois à des effets d’anéantissement idéique et à des troubles du langage fréquents dans la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Le dément répète, car il ne souvient pas. Il répète à l’infini, tendu vers l’Autre, tout comme Freud délivré par son ami, pour se libérer de cette contrainte réelle, du Réel de ne pouvoir dire et donc être. Cette répétition, parfois à l’infini, des productions démentielles, épuisantes pour les soignants et l’entourage, signe la persistance d’une dépendance humaine au langage. Toutefois, cette répétition peut être perçue comme relevant du non-sens. C’est ainsi que Luce Irigaray (1973, p. 351) approche le dément à partir de ses troubles du langage : « Parlé plus que parlant, énoncé plus qu’énonçant, le dément n’est donc plus, à strictement parler, un sujet d’énonciation actif. Il ne génère plus de discours. Il n’est que le locuteur passif d’énoncés antérieurement produits » [ibid., p. 351]). Luce Irigaray ajoute : « On pourrait parler, à la limite, d’un langage se répétant lui-même et non d’un locuteur faisant appel à la langue pour transmettre effectivement un message » (ibid., p. 47). Ces analyses sont toujours d’actualité dans la plupart des publications des chercheurs Eustache (1999), Garrelli De Guillebonc (1999). Si le dément ne peut, en effet, seul produire de discours, a contrario, être acteur en continuité d’une énonciation semble possible (André Quaderi, 2003). Lors de nos évocations cliniques, nous initions la production d’un échange verbal à la suite des cris, des hurlements, ou de l’apathie. Mme R. et Mme Porte expriment, selon nous, par leurs attitudes angoissées et répétées, ce manque de disponibilité des mots, cet impossible oubli qui autorise l’accès à la parole. Nous analysons l’agitation à répétition du dément comme la transformation du non-sens en comportement de décharge motrice (cris, agitation, etc.). Ces conduites appellent, happent, le praticien dans une clinique à l’extrême de la relation humaine. Le dément pressent qu’il savait, sans comprendre pour autant, pourquoi il ne sait plus, et ce, presque irrémédiablement. Ce savoir sur sa mémoire bute sur le réel de la maladie organique, nous pourrions presque avancer que ce savoir dépossédé devient forclos (2). Tout comme la dame âgée de Freud, le dément répète, recherche inlassablement, par son comportement, une quête de sens. La sidération répétitive du dément se comprend comme une requête incessante adressée à lui-même et à son entourage du paiement de sa dette à la parole. Ainsi, l’agitation et les répétitions du dément expriment la dépendance de l’humain – dément au fait du langage. Les comportements démentiels du malade atteint de maladie d’Alzheimer et apparentées dévoilent ainsi des processus psychiques en fin de vie, désorganisés par l’absence de l’oubli freudien.
Comment alors réduire (à défaut de guérir) cette agitation et cette compulsivité, là où Freud échoue avec cette dame âgée confuse ?
Les effets d’énonciation comme éléments de subjectivation
Si le rappel du nom Signorelli délivre Freud du refoulé et supprime sa contrariété, la parole du clinicien peut libérer, un temps, le dément de sa sidération répétitive. M. D., résident dans l’institution maison de retraite où nous officions, répète à l’identique une demande de quitter ce lieu pour retourner en Corse. Après un repas organisé, confectionné avec lui, pour lui et par lui, il devient joyeux, reconnaît le clinicien, ce qui malgré les entretiens fréquents n’était jamais arrivé. Enfin, il verbalise ses pertes de mémoire, verbalisation extrêmement rare dans cette affection du fait de l’anosognosie de la façon suivante : « J’ai oublié cela » ou encore « Comment ai-je pu oublier cela, mon cher ami ? » Des traces mnésiques de l’oubli demeurent donc, car il faut avoir une mémoire pour se souvenir de ce que l’on ne se souvient pas. Comment comprendre alors ces verbalisations si ce n’est comme directement dépendantes de la situation subjective?
Freud repère la compulsion de répétition avec le transfert : « Nous observons bientôt que le transfert n’est lui-même qu’un fragment de répétition et que la répétition est le transfert du passé oublié. » Le transfert permet de briser la compulsion à la répétition pour la « transformer en souvenir » (Freud S., 1914, op. cité, p. 113). Cette transformation impossible (pour la maladie d’Alzheimer) provoque la mutation du dispositif clinique en une intervention dialogique du clinicien. Au transfert analytique du patient, nous substituons un processus de remémoration du clinicien de sa relation au dément. En d’autres termes, le clinicien s’acquitte (de façon fragmentaire, parcellaire) de la dette à la parole du dément, en remémorant à sa place des éléments du passé commun, pour M. D. le repas. En effet, la verbalisation de ses oublis par M. D. dépend de l’intervention du clinicien dans le champ transférentiel des entretiens clinique. En aucun cas, les patients atteints de démence ne peuvent se souvenir qu’ils ne se souviennent pas sans la présence de l’autre, ici trésor des signifiants au sens le plus fondamental qui soit. La répétition dans la démence de mots, de souvenirs à l’identique, comme Mme Porte avec les « O… » et ses « chèvres », comme Mme R. avec ses compliments d’ordre sexuel sur le clinicien, ne se confond pas avec la répétition dans la cure. Le dément ne peut recouvrir par ses propres mobilisations psychiques (la remémoration et la perlaboration) ses oublis et analyser (dans le transfert) les processus de refoulement. À cette spirale de non-sens, seule la parole du clinicien viendra « boucher » momentanément le déficit démentiel. Lors de nos exemples cliniques, le praticien introduit le dialogue par ses propres associations, permettant ainsi de redonner à « la lalangue » sa singularité discursive, le temps de l’échange. Le clinicien incarne en quelque sorte, et à son grand étonnement, l’oubli freudien du dément. Par là même, le praticien concourt à la réanimation de la métonymie de la parole, de l’irruption de l’Autre dans le dédale démentiel. Jacques Lacan (1955, p. 431) explique l’Autre comme « le lieu où se constitue le je qui parle avec celui qui entend, ce que l’un dit étant déjà la réponse et l’autre décidant à l’entendre si l’un a ou non parlé ». De surcroît, Jaques Hassoun (1993, p. 103) spécifie trois acceptions de l’Autre : « le premier Autre, la mère en l’espèce, l’Autre comme lieu du refoulement originaire, l’Autre, comme trésor de signifiant ». Le dément ne parle, n’active la parole, qu’à la condition d’ouverture des mots de l’Autre. Ici, cet Autre peut être le praticien, mais ailleurs tout soignant, s’inscrivant dans une pratique maternante dans le sens du lien archaïque de protection. Cette acception de la notion de l’Autre ne peut se dévoiler qu’à la condition d’une mise en acte, de parole, des souvenirs du clinicien dans une relation au patient. De cet engagement éthique, nous pouvons espérer sortir de la mise en abyme de la démence le temps des mots. Là où Freud repère un transfert rapide, trop rapide avec la dame âgée, nous repérons une attente disproportionnée de la personne atteinte de démence vis-à-vis de son interlocuteur, attente totalement inféodée à cette dépendance à l’autre, comme véhicule de la parole signifiante, polysémique.
Dans le texte freudien, la mémoire ne se donne pas d’elle-même, elle trébuche pour se révéler. Les chemins de traverse de la remémoration par le transfert permettent d’en saisir le sens. Pour le dément, cette remémoration demeure retranchée par la dégénérescence neurologique. Un pont langagier entre le praticien et le dément demeure toutefois possible. Le contexte du transfert permet au patient en analyse de déplacer ses oublis et d’en découvrir les constructions inconscientes. Ce qui peut fonctionner comme dispositif dans la démence se repère dans la rencontre subjectivante avec le clinicien, en recouvrant une discursivité de la parole. Le clinicien serait ainsi dans une place A, trésor de signifiants au sens premier du terme : lieu où s’énonce un dit constituant par le « je » qui parle (le praticien), le « je » qui entend (le dément). S’il faut être deux pour se souvenir dans la clinique analytique, avec le dément, cela devient une nécessité absolue. La conscience de soi passe, dépend de l’Autre, tout comme la réapparition des souvenirs. De cette impérieuse dépendance humaine, le poète métaphysicien John Donne (1627, p. 17) écrit : « variable, et donc misérable condition de l’homme ». ■
Notes
1. La clinique du dément nécessite une pratique à focale multiple.
2. La notion de forclusion du sens comme effet des troubles du langage ne peut être plus amplement développée ici.