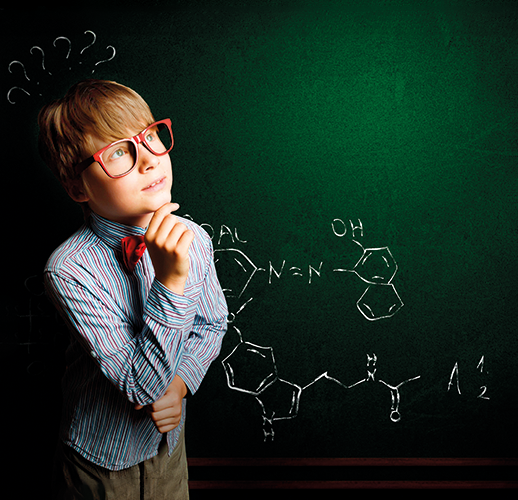Dossier : journal des psychologues n°246
Auteur(s) : Ben Soussan Patrick
Présentation
Autrefois il était d’usage de dire d’une femme enceinte qu’elle attendait un « heureux évènement ». La formule paraît désuète, mais l’évènement demeure, forcément heureux. Or, il arrive parfois qu’un écart surgisse entre le Bébé attendu et celui de la réalité. Comment en faire l’annonce ?
Détail de l'article
Le Golem et Pygmalion
« Tes yeux me voyaient quand j’étais une masse informe et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m’étaient réservés avant qu’un seul fût éclos. (1) »
Il fut un temps où il y avait un grand Rabbin à Prague. Son nom était Rabbi Yehuda Loewe – ce qui signifie « lion » en allemand et en yiddish – et il était connu dans la tradition juive sous le nom de « Maharal de Prague ». La légende populaire rapporte que cet érudit célèbre et kabbaliste créa le Golem, dans le dessein de protéger le ghetto juif de Prague, à partir d’une masse d’argile informe à qui Dieu aurait donné le souffle, lui permettant de devenir « Adam », l’être premier provenant de la Terre et composé de sang (dam) et d’une « étincelle » divine (la lettre « a », aleph en hébreu). Le Golem pouvait travailler, remplir les obligations de son maître et accomplir toutes sortes de corvées à sa place, sans toutefois avoir le don de la parole : il avait aussi et surtout pour fonction de protéger les juifs reclus du ghetto de Prague contre les persécutions et ceux-ci auraient alors connu une longue période de quiétude et de prospérité. La vie lui aurait été donnée en inscrivant emeth (« vérité » en hébreu) sur son front et en introduisant dans sa bouche un parchemin sur lequel était inscrit le nom de Dieu. Pour le tuer, il aurait fallu effacer le premier E (un Aleph, en hébreu), car meth signifie « mort ».
Or, à la suite de certains événements confus, cet androïde aurait échappé à la volonté de son créateur et déclenché une violence incontrôlée, menaçant de tout détruire autour de lui. Certaines versions du mythe assurent qu’il se retourna même contre son propre « père » et le tua ; d’autres rapportent que celui-ci aurait réussi, à la dernière minute, à l’anéantir.
Ce Golem n’était-il au fond qu’un ersatz de Messie vengeur ? En fait, sa figure légendaire fascine depuis des siècles et elle n’a pas manqué d’enflammer l’imagination de nombre d’écrivains, dont Goethe lui-même – dans son Faust ou plus encore dans le poème l’Apprenti-sorcier –, les frères Grimm, E.T.A. Hoffmann, Carlo Collodi – Les Aventures de Pinocchio – Mary Shelley – Frankenstein ou le Prométhée moderne – et même Disney dans Fantasia. Comment expliquer un tel engouement ? Par le mythe de la création qu’il re-examine – l’homme peut-il imiter Dieu ? Adam est ainsi à Dieu ce que le Golem est à l’homme, une créature nécessairement imparfaite – puisque dépourvue d’âme et de parole.
Depuis des époques reculées nous sont parvenus des récits et des mythes qui évoquent le passage des Dieux aux humains, créateurs de vie : les anciens Grecs, Chinois ou Indiens avaient déjà imaginé des créatures à leur image, ou des objets animés de vie. Le mythe de Pygmalion en constitue un archétype fondateur (2). Pygmalion, jeune roi de Chypre, était un grand sculpteur qui se consacrait pour l’essentiel à son art. Il « sculpta dans l’ivoire à la blancheur des neiges un corps auquel il donna une beauté qu’aucune femme ne peut tenir de la nature », rapporte le poète Ovide. Il tomba amoureux de sa création qu’il appela « Galatée » (« amour endormi »), et à qui la vie fut « insufflée » par Aphrodite, déesse de l’amour et de la beauté. De leurs amours naquit une fille, Paphos. Le mythe de Pygmalion a, depuis Ovide, connu une fortune exceptionnelle en littérature et dans les arts plastiques : la magie de la métamorphose, la mise en scène du geste créateur, la palpitation de la vie y sont invoquées.
Rabindranath Tagore, poète et philosophe indien, se demandait quelle alchimie secrète engageait les « jardiniers d’amour » à ces moissons de la vie ? À cette question, sans cesse renouvelée depuis la nuit des temps, qui fera réponse ? Qui résoudra ce secret du monde, qu’il résumait en ces mots : « D’où suis-je venu ? Où m’as-tu trouvé ?, demanda l’enfant à sa mère. Elle pleure et rit tout à la fois et, le pressant sur sa poitrine, elle lui répond : « Tu étais caché dans mon cœur, mon chéri, tu étais son désir. Tu étais dans les poupées de mon enfance et quand, chaque matin, je modelais dans l’argile l’image de mon Dieu, c’était toi que je faisais et défaisais alors. Tu étais sur l’autel avec la divinité de notre foyer ; en l’adorant, je t’adorais... (3) » La question des origines, de nos origines, dans sa violence archaïque et son éblouissante énigme, est sans relâche redoublée. Elle se déploie sous le grand apparat du bébé, celui que l’on imagine avant même qu’il naisse, celui qui peuple les pensées et les rêveries de tout parent, celui qui vient de notre préhistoire, du fin fond de nos inconscients et porte témoignage, à notre insu, de nos désirs les plus secrets et des fantomatiques secrets que l’on se passe de génération en génération.
Tout parent est le Maharal de Prague, Pygmalion, ou ce jardinier d’amour et leur fleur, en ce jardin de leur parentalité, ne saurait être qu’une rose sublime, leur enfant. Mais tous les parents sont assurés que les épines des roses ne sont qu’horticulture et, qu’au chapitre de leur puériculture irraisonnée, la vie de leur rose ne peut qu’être enchantée. Qui ferait des enfants, sans cette quiète assurance, qui s’engagerait dans la vie sans dénier la mort, qui postulerait son infortune avant qu’il ne naisse, cet enfant de rêve, qui se persuaderait par avance des malheurs à venir, des souffrances, des maladies, qui, peut-être, sûrement, seront son lot ?
Tout enfant né ou à naître est le fruit même de ce déni, de cet irrépressible déni de la souffrance et de la mort. Que d’effusion narcissique en ce projet ! Quel démiurge dessein !
Il n’est (naît) qu’un rêve d’enfant
« L’enfant doit avoir un sort meilleur que celui de ses parents, il ne doit pas être soumis aux nécessités dont on a reconnu qu’elles dominent l’existence. La maladie, la mort, le renoncement aux jouissances, les limitations imposées au propre vouloir, ne doivent pas valoir en ce qui le concerne ; les lois de la nature ainsi que celles de la société doivent s’arrêter devant lui ; il doit, de nouveau, être véritablement le centre et le noyau de la création. His Majesty the Baby, tel que jadis on croyait l’être. (4) »
L’enfance a très souvent été décrite comme un jardin des délices, un Eden, rempli de plantes « bonnes à manger et séduisantes à voir (5) ». C’est cette vision paradisiaque qui est convoquée par tous, poètes, écrivains, peintres, mais plus simplement par nous tous, parents en devenir ou déjà établis. Rien de moins qu’un mythe ! Ce pays est bien le royaume de l’innocence, du rêve et du merveilleux. Un temps et un espace de béatitude, d’une éblouissante clarté, le temps des floraisons, des bourgeons, des chemins sinueux, à l’ombre de la mère, main dans la main, sans écart.
His Majesty the Baby, comme le dit Freud, est le totem de ce rêve d’enfance, de ce rêve d’enfant, objet fétiche et nouveau Veau d’or de nos civilisations du malaise. Nous abordons là ce Never Neverland, ce pays du grand Jamais, cette île de l’éternelle enfance, l’île où nous avons tous été un jour, que nous avons quittée petit à petit en grandissant, mais que nous n’avons jamais oubliée en devenant adulte, plus encore que nous avons reconstruite de toutes les pièces de notre imaginaire.
C’est en cette île que naissent les enfants. Tous les enfants. C’est là, et nulle part ailleurs, que doivent naître les nôtres.
Quand l’homme de la pluie, sur le midi de sa vie, vous, moi, nous embarquons pour quelque régate de la mémoire, vers ces lieux oubliés de notre plus jeune âge, ce temps révolu d’un paradis, perdu sitôt que connu, nous rêvons de l’enfant du beau temps. Nous sommes tous habités par la nostalgie de ces temps de navigation précoce, temps hors du temps, hors de tout et de tous, que nous avons connu à l’aube naissante de nos vies. Ces mois, ces années ont laissé à jamais trace en nous, immuable, impérieuse et par d’insolites vues de l’esprit, sans relâche, nous nous exerçons à retourner vers ce pays de Cocagne, ce jardin des Délices où, selon le poète Baudelaire, tout n’est « qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Tout nous ramène, toujours, vers l’enfance et ses terrae incognitae, cette « époque préhistorique », qu’évoquait S. Freud. Le seul galion – ou la galère – royal, qui peut encore nous conduire en ces Amériques lointaines, n’est pas tant le souvenir que l’imagination : le premier porte la trace de cette amnésie infantile qui nous laisse troués de blancs et de silences ; le second se fraye des chemins de traverse entre souvenirs vécus et recomposés.
Pascal, dans sa Pensée 146, s’interrogeait : « Qu’est-ce donc que nous crient cette avidité et cette impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable ? » Le bébé de notre imaginaire serait-il cet objet infini et immuable, nostalgique d’un temps perdu, inlassablement recherché, jamais retrouvé, toujours espéré (6) ?
Le bébé imaginaire aurait-il donc cette vertu inestimable de rendre à notre humanité sa part de rêve ? Et de rendre à l’autre, aux autres, à celui et à celle qui nous ont « faits », un peu – ou beaucoup – de cette part indélébile d’eux qu’ils nous ont transmis. Endettés de la vie, nous nous rachetons sur la chair même de cet enfant qui est notre tribut à la vie qu’ils nous ont donnée.
Le handicap qui épelle le réel
Un enfant est né, un enfant va naître.
Mais, voilà, il arrive parfois qu’un jour, ce jour qui devait être le plus beau de leur vie, le jour de la naissance de leur enfant, mais parfois même avant, pendant la grossesse, ou encore après, des mois après, parents et enfant soient précipités, avec une violence inconcevable, dans un monde inconnu de souffrance et de douleur. Souvent quelques regards, quelques mots, de trop lourds silences ont suffi… Et, de ce jour, meurtris, vacillants, commence pour eux une nouvelle vie à laquelle rien ni personne ne les avait préparés.
Ces nourrissons ou ces fœtus, ces enfants, porteurs de malformation congénitale, de handicap, de séquelles graves de maladie, toutes ces porcelaines d’humanité, si fragiles, si vulnérables, qui émeuvent, bouleversent, affligent, fascinent ou menacent, confrontent les parents à un bouleversement majeur où se disent la perte, la rupture des rêves, des espoirs d’avenir, de la lignée, les angoisses de mort, la peine et la haine.
Comment penser alors accueil, accompagnement, équilibre, tenir bon, résister, revivre ? Comment aider ces parents à vivre ces moments si difficiles, à les dépasser et à continuer leur vie, avec cet enfant différent ? Comment aider ces enfants, contraints dans leur corps et leur psychisme par d’irréductibles entraves ? Comment aider ces professionnels – sommés par les familles, le monde médical, le monde social, peut-être aussi par leur seule vocation à soigner – dans leurs pratiques et tous ces mouvements affectifs si forts qu’ils ne manqueront pas de connaître ?
Comment dire ce monde où l’on entre habituellement sans frapper ? Y entre-t-on d’ailleurs vraiment par des paroles médicales, entendues, pensées et à jamais présentes ? Comment ces mots de l’annonce se formulent en un effet de fixation doué d’éternité ou tout du moins d’une atemporalité incroyable : dix jours ou dix ans après, les parents attestent de leur « vivance » en eux. Constituent-ils à eux seuls une véritable interruption de fantasme, une amputation de la charge imaginaire de leur parentalité, un trauma psychique ? Que dévoile et recouvre donc le discours médical ? À quelles annonces fétiches sommes-nous encore référés ? Quel mode de désignation et de nomination sous-tendent les paroles dites, entendues ou pressenties ? Comment leur attribuer une fonction d’ouverture, vitale, là où souvent elles ne sont vécues que comme rupture, enfermement, incarnation du monstrueux, de l’échec et de la honte coupable ?
Au total, comment ces mots de l’annonce pourront-ils être reconnaissance d’humanité mais aussi d’altérité ? Et plus que « comment les dire », comment les rendre audibles et signifiants pour tous ?
Pour que ces mots laissent de la place à d’autres, pour que l’enfant handicapé ne soit pas qu’un handicap. Pour qu’être handicapé s’assure d’abord de l’être, avant que du handicap. Pour que parents et professionnels ne soient plus aliénés à ce seul effet de discours et que dans cette « situation extrême » les paroles ne s’écrivent pas comme un destin.
Les dits du handicap, l’édit du handicap
Nous sommes entrés dans le XXIe siècle. Tous les rêves du monde, d’espoir ou d’apocalypse, se sont soudainement cristallisés sur cette année 2000, si prompte à révéler les fantasmes de notre modernité.
À la radio belge, lors d’une émission interactive avec les auditeurs, dont le thème portait justement sur cette date fatidique et sur les aspirations ou appréhensions qu’elle suscitait, la voix monocorde et lointaine d’une femme d’une cinquantaine d’années qui soudain vient rompre le rythme enjoué des échanges. Aux questions habituelles sur le métier exercé, ses occupations et loisirs, elle répondit qu’elle restait chez elle, pour garder son enfant handicapé dont on apprendra plus tard qu’il a trente ans. Malgré les efforts répétés de l’animateur, jusque-là si alerte, le silence s’abattit sur l’antenne, traversée par cette voix sourde qui trouvait là une résonance si particulière et qui disait une vie de souffrances et de sacrifices. Au bout d’interminables secondes de silence, le présentateur de l’émission remercia vivement cette femme pour son « témoignage », insistant sur tout son courage et sa dévotion et formulant ses bons vœux pour que « au XXIe siècle, tous les handicaps disparaissent de cette Terre »… Il ponctua, avant de passer la parole à d’autres auditeurs, « les médecins ont encore du pain sur la planche ».
Michel Del Castillo écrit quelque part que « la souffrance impose le silence » et Emmanuel Levinas assure qu’« il n’y a nul refuge à la souffrance ». Alfred de Vigny dans « La mort du loup » continue. « Seul, le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. » Et l’impression récurrente qui demeurait au terme de cette rencontre sur les ondes était bien celle-ci : le malheur des uns ne doit pas venir ternir le bonheur des autres, il doit rester dans l’ombre, dans le non-dit, en souhaitant ardemment que d’autres, et ici les médecins qui étaient interpellés, puissent le contenir, le museler ou le faire disparaître. Le handicap, sauf à en exacerber sa dimension de voyeurisme et de jouissance devant la souffrance de l’Homme, n’a pas bonne presse et n’est pas un bon produit, aux heures de grande écoute. Les médecins, les professionnels, sommés ici de mieux garder leur troupeau ou de faire en sorte, dans une radicale proposition, de faire disparaître ces désordres, auraient-ils pour mission de faire taire le handicapé et ceux qui parlent de lui avant que le rêve qu’un jour, le handicap n’existe plus, n’advienne à la réalité. Au XXIe siècle ?
Petit détour en suivant, des ondes à la presse écrite. En septembre 1998, ce témoignage dans un article intitulé « Les dents de la mort » du mensuel Quo, autour du thème des plombages dentaires dangereux pour la santé.
Une jeune femme de vingt-sept ans, mère d’une petite fille de trois ans, évoque la plainte qu’elle a portée contre X pour empoisonnement. Elle se confie : « Durant mon enfance, on m’a posé une dizaine d’amalgames en moins de quatre ans. En 1977, j’ai appris que j’avais un taux énorme de mercure dans la salive. Ma fille est née en 1995 avec une lésion cérébrale. Elle est handicapée à 80 %. J’ai alors demandé des analyses qui ont montré qu’elle avait beaucoup de mercure dans l’organisme. D’où peut venir ce poison si ce n’est par un transfert durant ma grossesse, puisqu’on n’a jamais soigné les dents de ma fille ni brisé de thermomètre dans la maison ? »
Sans prendre cet énoncé à la lettre, on est contraint de s’interroger sur l’étiologie du handicap ainsi certifiée par cette mère. Que dit-elle là, sinon que le handicap se définit en un essentiel et péremptoire questionnement, une seule et unique question : pourquoi ? Un pourquoi qui ouvre sur une chaîne infinie d’interrogations et plus encore constitue une véritable quête initiatique.
Les parents d’un enfant porteur d’un handicap partent toujours en quête, en quête de sens, et leurs interrogations, multiples, incessantes, trouvent souvent fort peu d’écho. Qui dira le pourquoi du handicap ? Qui expliquera pourquoi cet enfant plutôt qu’un autre ? « Pourquoi nous ? » Qui justifiera cette atteinte ? Qui expliquera les lésions et les troubles d’aujourd’hui et qui prédira ce que demain sera ? Qu’y pouvons-nous et qu’en ferons-nous ? Que deviendra cet enfant, aujourd’hui, mais demain surtout quand nous ne serons plus là ? Pourrons-nous avoir d’autres enfants, seront-ils semblables ou différents ? Comment vivre tout cela ? Comment supporter, comment continuer ?
Il lui annonce les séquelles neurologiques que son enfant va garder, graves, de sa souffrance fœtale et de sa naissance difficile. Après plusieurs jours d’incertitude, d’attente anxieuse, d’examens, d’espoirs sitôt balayés, si vite retrouvés. Elle écoute le médecin, entend-elle ? Il se tait. Après d’interminables secondes d’un silence si chargé, elle se redresse, paraît s’éveiller, reprendre ses esprits, elle secoue sa tête, rassure son bébé qu’elle portait dans ses bras et se dirige d’un pas assuré vers le porteur de mauvaise nouvelle en blouse bleue. « Tenez, reprenez-le, je n’en veux pas. Je ne veux pas de ça. Débrouillez-vous. »
Tout aussi décidée, elle remet le « bébé » au médecin, dans ses bras médusés et offerts, tourne les talons, franchit le couloir au pas de charge, le sas de l’unité de néonatologie et dévale l’escalier. En quelques secondes, elle a disparu. Toute l’équipe est là, sidérée : sans avoir pu placer un mot, esquisser un geste. J. Testart assurait que nous entrions dans « l’ère des naissances merveilleuses, celles des contes de fées, des médecins cigognes qui apportent les bébés » et il prophétisait que la marchandise livrée « devrait être conforme aux désirs parentaux, sinon gare au service-retour. » Ce petit bébé, hors normes, a-normal, se retrouvait ainsi comme retourné à « l’envoyeur. » « À la fin de l’envoi, je touche », écrit le Rostand de Cyrano : il ne s’agissait pour cette mère que de faire retour de la violence qu’elle avait reçue en plein cœur, en pleine aube de la vie naissante de son enfant. Ce n’était bien sûr pas tant son enfant qu’elle refusait, que ce « ça », innommé, innommable, inhumain, impensable et inconcevable. « Ça n’est pas possible », « ça n’est pas vrai », « ça ne peut pas arriver », « ça n’arrive qu’aux autres », « Qu’avons-nous fait pour mériter ça ? » : le « ça » désigne pour tous les parents la forme syncopée de leur bouleversement, la puissance des représentations en œuvre et la violence très pulsionnelle, engendrée en de tels instants où la vie entière semble basculer, le ciel vous tomber sur la tête et la folie du monde sans limites. Car, s’il faut se débarrasser au plus vite de « ça », l’éliminer, l’annihiler, voire le rendre à ceux qui l’ont nommé, qui n’ont pu l’assurer contre la nature défaillante, la génétique incertaine, la maladie, le destin, le hasard, … c’est bien parce que « ça » n’est pas un enfant et plus encore « ça » n’est pas notre enfant. Les dits sur le handicap édictent le handicap. C’est en le nommant qu’un handicap s’affirme. Par cet acte de nomination, il prend forme, vie et épelle le réel, à sa façon, violente et traumatique.
Le miroir brisé (7)
« La créativité, c’est conserver tout au long de la vie une chose qui, à proprement parler, fait partie de l’expérience de la première enfance : la capacité de créer le monde. (8) »
Parfois, en un éclair, le miroir de nos rêves se brise... L’ombre de nos cauchemars les plus terribles s’étend sur le réel de notre vie. Notre enfant n’est pas ce génie, cette merveille des merveilles que nous appelons tous de nos bons vœux, ce rêve – qui ne peut qu’advenir n’est-ce pas ? Notre enfant naît autre, est dit « différent »,... L’ange descendu tout droit des cieux vers nous se mue soudain en...
Notre enfant est handicapé...
Et nous, quels parents serons-nous pour lui ?
De quels éducateurs, soignants, professionnels, aura-t-il besoin et sera-t-il entouré ? Quels humains, semblables et différents, habiteront le monde dans lequel il aura choisi de vivre ? Dans lequel nous aurons choisi de vivre ?
Lors de l’annonce d’un handicap, d’une malformation, d’une maladie grave ou létale, en anténatal, à la naissance ou autour de la naissance, dans ces temps si prégnants des premiers développements de l’enfant, l’effet traumatique de ces révélations vient sidérer les parents, paralyser leur pensée, figer leur imaginaire et leur incapacité d’élaboration témoigne bien du pouvoir de déliaison de cette expérience. En ces temps d’effusion narcissique, de vulnérabilité parentale, l’irruption impromptue de cet événement peut parfois emporter le bébé de leur imaginaire au loin, très loin, en ces lieux désertés par la vie.
Ces annonces ont projeté les parents et leurs proches dans un monde bouleversé et bouleversant où leur Bébé de rêve n’a plus grande place, tant est occupé leur esprit et tant leur affectivité est mobilisée. C’est une véritable interruption de fantasme, une amputation de la charge imaginaire de motion inconsciente, que nul dessein intentionnel ne signe et qui s’impose aux parents.
En 1919, S. Freud évoquait l’inquiétante étrangeté, qui rendait compte pour lui de « tout ce qui aurait dû rester secret et caché mais qui est venu au jour ». Il ajoutait que ce sentiment surgit « chaque fois que les limites entre imagination et réalité s’effacent, où ce que nous avions tenu pour fantastique s’offre à nous comme réel ». Rappelons-nous que tout bébé s’épelle en ses deux faces, merveilleuse et diabolique. Quand le fantasme devient réalité, quand le bébé qui tombe au monde ou qui est annoncé correspond trait pour trait à ce bébé cassé, malformé, insatisfaisant, quand les parents posent leurs yeux sur un nourrisson différent, à l’échographie, en salle de naissance, en maternité, cette inquiétante étrangeté ne peut que les assaillir et l’effroi les saisit. Leur Bébé « dans la tête » subira alors un véritable changement catastrophique, une transformation majeure : il perdra ses attributs de rêve, son avenir doré, son statut d’idole, pour se mettre entièrement et avec un mortifère dévouement au service du handicap. Il forcera ainsi à penser que l’enfant à naître, ou déjà né, n’est que handicap, incompétence, déficience, que son humanité même est incertaine, que sa filiation est entachée de tous les péchés de la lignée ; qu’il va « pourrir la vie » de la famille, l’enfoncer dans l’abîme, la mener à toucher le fond de la vie ; qu’il n’a pas d’avenir, sinon de peines et de souffrances, et que son existence sur Terre sera grevée de tant de limitations irréductibles.
Cet enfant, tout à coup, roulera en lui toutes ces représentations de la honte, de la culpabilité, de la folie et de la mort. Car si nous sommes tous, humains, en attente d’un rêve, à espérer l’infini et le meilleur, pour nous et les nôtres, nous sommes tout autant terrifiés par l’autre, la différence, l’étrangeté, tout ce qui ne se rapporte pas au même, à l’identique, au connu, au familier.
Il faut alors rappeler solennellement qu’il n’y a pas de recettes à l’annonce d’un handicap à la naissance. Comment rendre intelligible ce moment dont le sens échappe à ceux-là mêmes qui le vivent ? En aucun lieu, en aucun temps, un tel réel se laisse facilement apprivoiser. Il n’existe pas d’annonce heureuse. Il n’existe pas de médecins heureux de faire l’annonce d’un handicap. Il n’existe pas de parents heureux d’être des parents d’un enfant handicapé. Il n’existe pas d’enfants handicapés heureux de l’être. Il n’existe que des histoires singulières, des rencontres singulières et nous devons tout faire pour aider les parents à survivre, à vivre ensuite, en renouant avec leur capacité de rêverie, de penser ; nous devons tout faire pour aider ces enfants à prendre leur place, toute leur place d’enfant ; nous devons aider les équipes à aider ces parents et ces enfants, et nous devons faire en sorte que le handicap n’handicape pas la vie de tous.
Et, résolument, nous engager à penser que l’annonce n’a de sens que si elle se conjugue à accompagnement et que notre travail premier se situe bien là, à cheminer avec ces familles « affectées », dans le temps. ■
Cet article reprend des extraits de l’introduction de l’ouvrage Annonce du handicap autour de la naissance en douze questions, Érès. Ouvrage présenté dans la rubrique « Lire ».
Notes
1. Tehilim, Psaume 139, verset 16. Dans la culture hébraïque, la première apparition du terme golem (« masse informe ») se situe dans la Bible, au Livre des psaumes, en ce verset 16, quand David s’adresse à Dieu.
2. Ovide, Les Métamorphoses, Livre X, v. 243-297 (5-15 après J-C.), Paris, Gallimard, 2005, Collection « Folio ».
3. Le Jardinier d’amour, (1920). La Jeune Lune, Paris, Gallimard, 1980.
4. Freud S. (1914), « Pour introduire le narcissisme », in La Vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 96.
5. La Bible, Genèse 2 : 9
6. Pour de plus amples développements de ces notions, se référer à mon ouvrage paru en 2002 chez Érès, dans la collection « Mille et un bébés », Le Bébé imaginaire.
7. Sausse S., Paris, Calmann-Lévy, 1996.
8. Winnicott D. W., Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975.