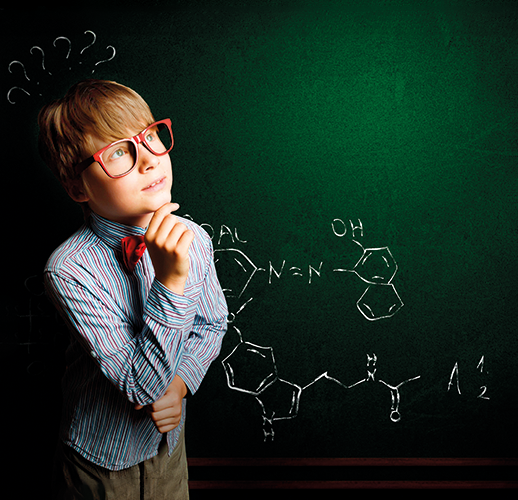Dossier : journal des psychologues n°246
Auteur(s) : Cavro Elodie
Présentation
La relation humaine est au centre de chaque plainte douloureuse : patient face à lui-même, en relation avec les autres, qu’il soit membre de sa famille, soignant ou professionnel. Dans un contexte où l’attention est pourtant attirée principalement sur le corps, c’est au psychologue de faire du lien interpersonnel la voie d’accès à la souffrance et le véhicule de son apaisement.
Détail de l'article
Dire que la douleur est un phénomène complexe et pluridisciplinaire est devenu banal. Dire qu’il n’existe pas une mais des douleurs, aussi. La présence de plus en plus systématique de centres antidouleur dans les hôpitaux nous confirme le souci croissant de les comprendre et de parvenir à les traiter. Néanmoins, il semble que nous butions encore sur les mêmes questions. La lutte contre la douleur est un combat difficile à mener d’autant qu’elle met fréquemment en échec la technique et le savoir scientifique. Ainsi, il semble exister dans chacune de ces douleurs comme une part indomptable, inaccessible pour le monde médical. Cette part appartient au psychique. Les douleurs dépendent donc de l’individu qui les vit, de ses représentations, de son histoire, de sa culture. La pluralité de ces douleurs renvoie de ce fait à une éminente singularité. C’est en cela qu’elles échappent et échapperont toujours un peu à l’exigence rationnelle de la rigueur cartésienne. Les professionnels de la douleur baignent dans une médecine fondamentalement tournée vers l’humain. Si nous persistons à le nier, par défense ou incompréhension, nous sommes voués à mon sens à l’impasse thérapeutique, au sentiment d’impuissance ou encore aux désastres du rejet de l’autre devenu le bourreau de notre narcissisme. Trop souvent, l’objectivation de douleurs physiques destitue la douleur psychique et réciproquement. Or, la douleur est le parfait exemple de cette unité psyché-soma. C’est un véritable nœud à l’intérieur duquel interagit une multiplicité de facteurs. Il convient pour éviter ces écueils de prendre conscience que nous ne prenons pas en charge la douleur mais un patient douloureux.
Face à chaque plainte douloureuse, la Relation avec un grand « R » est mise en jeu : la relation du patient à lui-même ou sa relation à l’autre, qu’il soit membre de sa famille, soignant ou psychologue. Dans notre pratique clinique, il me semble qu’observer, écouter, interroger et analyser les modalités relationnelles offertes ou attendues par chacun est une des façons de lire la souffrance, une sorte de voie d’accès intéressante, voire privilégiée, à sa compréhension et à la prise en charge du malade.
Je propose ici d’analyser le fonctionnement des patients douloureux au regard de leur fonctionnement relationnel et de leur façon de communiquer. Je vais tenter dans les lignes, qui vont suivre, d’ouvrir une réflexion sur les liens étroits, sinueux et conflictuels entre quatre grands visages de notre clinique : la douleur, la souffrance, la subjectivité et l’intersubjectivité. Mais, avant, il peut paraître bon de revenir sur un débat de tradition, celui qui oppose la notion de « douleur » et la notion de « souffrance. »
Il paraît évident que persiste toujours un amalgame entre douleur et souffrance. Cet amalgame vient du fait que ces deux notions s’entrelacent souvent au sein d’une même plainte, autour d’un même suivi. Douleur et souffrance agiraient l’une sur l’autre.
À mon sens, la souffrance serait à rapprocher de la douleur psychique. Il s’agirait de la douleur pensée, de la part affective de la douleur, qui est et reste un phénomène physiologique, une expérience sensorielle. Ses mécanismes, contenus dans le corps, sont donc entièrement inconscients. La souffrance, elle, relèverait d’une lecture émotionnelle et cognitive du vécu désagréable. En ce sens, elle se déploierait préférentiellement sur le paysage du conscient. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples. En tant que phénomène psychologique (ou moïque), elle n’échapperait pas non plus à l’empiètement et à l’influence de forces inconscientes. Si une douleur ne peut rester muette, c’est bien souvent la souffrance qui parle à sa place. Le patient est dans un état qui peut se dire ou se décrire, mais qui transporterait en même temps tout ce dont une personne peut être faite ; c’est-à-dire de son histoire et celle de sa famille, de ses représentations, de ses angoisses et bien sûr de ses expériences douloureuses antérieures. Aussi vrai que le corps possède une mémoire, une plainte douloureuse porterait aussi l’empreinte d’anciennes souffrances, qu’elles soient individuelles ou transgénérationnelles. Autrement dit, personne n’aurait mal pour la première fois.
C’est à cette ambiguïté et à cette transversalité que nous devons en partie les difficultés, voire les échecs, de nos prises en charge. (J’ajouterais que ces échecs concernent plus souvent les patients douloureux chroniques, mais j’y reviendrai un peu plus loin.)
Je crois que nous sommes encore loin de pouvoir clore le débat. Néanmoins, reprenons le cours de nos réflexions et penchons-nous tout d’abord sur le fonctionnement relationnel des patients atteints de douleurs aiguës.
Douleur aiguë : un biais dans la relation
La douleur aiguë est initialement considérée comme un signal d’alarme révélant l’existence et souvent la localisation d’une lésion ou d’un dysfonctionnement organique ou physique. Elle se différencie de la douleur chronique par ses caractéristiques, entre autres, d’intensité et de durée, et entraîne des comportements réflexes de protection. Malgré tout, la médecine essaye de la prévenir et de la réduire.
Un patient hyperalgique a une économie psychique bien particulière ; ses modalités communicationnelles et intersubjectives s’en trouvent largement biaisées. En observant les patients, notamment les patients hospitalisés en postopératoire, il apparaît qu’elle tend à les vider en partie ou totalement de leurs possibilités relationnelles et verbales. Durant un entretien, la survenue d’un pic douloureux chez le malade altère ou interrompt instantanément le cours de son discours et fait fracture dans la dynamique interpersonnelle. Celui-ci a alors tendance à fermer les yeux et à afficher sur son visage ces mimiques que nous connaissons bien. Généralement, le corps se tord, se raidit. Il communique l’état intérieur du patient, mais ne peut baisser suffisamment sa garde pour laisser la parole prendre le relais. Ce moment est souvent assez court, mais il illustre bien ce qu’il se passe pour chacun des protagonistes de la relation. Paul Ricœur parlait déjà d’une véritable « crise de l’altérité. »
Un vécu partagé mais fondamentalement non partageable
En analysant de plus près notre vécu à ce moment-là, il est possible de ressentir cette distance qui vient de s’instaurer avec le patient en pleine crise douloureuse. Le malaise qui en découle est parfois presque palpable. Que l’on soit psychologue, médecin ou infirmière, nous ne pouvons ressentir ni imaginer la douleur de l’autre. D’ailleurs, il serait fort déplacé de prétendre le contraire et de le dire au patient. On ne saurait rappeler combien la phrase « Je sais ce que vous ressentez » est inutile, voire néfaste à la relation. Elle ne fait que lui renvoyer l’éblouissant reflet de notre propre malaise et, paradoxalement, nous met à distance en nous rendant moins empathique. La douleur, par essence, est une sensation, une expérience que l’on vit seul. Le partage qui était possible jusqu’alors, grâce au discours, aux représentations ou même à la communication non verbale, ne l’est plus. Quand on a mal, on n’entend plus, on ne parle plus, on ne pense plus.
Ce moment d’exclusion mutuelle où la douleur « prend corps » nous ramène un peu à notre propre ressenti intérieur et nous confronte aussi à cette part de l’autre en nous qui a peur d’avoir mal. Dans le dossier rédigé par le laboratoire d’éthique médicale et de santé publique de la faculté de Necker à Paris, les auteurs rejoignaient ce point de vue en écrivant que : « La douleur est paradoxale en ce qu’elle est une expérience qui demande à être partagée, du moins comprise pour être traitée mais sans jamais pouvoir être partagée. » Ils poursuivent en expliquant qu’elle « cristallise la limite d’appréhension et de compréhension entre deux individus qui sont dans un monde commun par leurs perceptions, leurs sensations et leurs émotions propres, qui ne peuvent partager leurs expériences qu’en se référant au rapport qu’ils ont eux-mêmes au monde, aux autres et à leurs propres corps. »
En tant que professionnel, il me semble effectivement important d’être à l’écoute de soi-même, afin de mieux s’en dégager, car l’intersubjectivité commence là où chacun se ressent sujet, à sa place et différencié de l’autre. Le patient doit pouvoir compter sur notre solidité psychique pour colmater les brèches de son intégrité. Or, cela serait impossible si nous nous montrions aussi abîmés que lui.
Le point de vue psychanalytique sur la question
L’approche psychodynamique me semble expliquer assez bien ce phénomène de repli et me servira de base à l’ensemble de ma réflexion. En 1926, Freud écrit dans Inhibition, symptôme et angoisse que « la douleur corporelle produit un investissement élevé, qualifiable de narcissique, de l’endroit du corps douloureux, investissement qui ne cesse d’augmenter et qui tend pour ainsi dire à vider le Moi ». Ainsi, la douleur vue comme un excès de stimulation ferait irruption dans le psychisme et attaquerait les défenses du sujet. Si Freud introduit le terme « narcissique », c’est bien pour signifier ce mouvement de centration sur le corps, à la suite de l’effraction douloureuse, de tous les intérêts et investissements jusqu’alors distribués dans l’ensemble du corps libidinal, dans la pensée et dans la relation. La métaphore communément utilisée est celle d’une véritable « hémorragie psychique. » Le patient se focalise sur la zone algique, surinvestit la sensation douloureuse, mais n’associe plus. Il incarne sa douleur, qui sidère le Moi et tout son système de communication et de représentations (Pédinielli et al., 1997). Autrement dit, elle désorganise. Elle peut agir d’ailleurs comme un véritable traumatisme. Le malade finit par désinvestir tout ce qui n’est pas « douleur. » C’est donc ainsi que nous nous trouvons exclus de la relation et que la communication, temporairement, se fige, se brise ou se perd.
Le retour au relationnel
Si la douleur aiguë court-circuite la pensée et les mécanismes de secondarisation pour se manifester dans la sphère comportementale, je fais l’hypothèse que la souffrance du patient le ramène dans la sphère du verbal et nous y amène avec lui. Elle correspondrait alors à la transformation de l’investissement narcissique en investissement objectal. C’est ainsi que la souffrance parviendrait à s’inscrire dans différentes formes de créations artistiques ou littéraires. Par sublimation et mise en métaphore, elle peut offrir ces liens dont la douleur le prive. D’après Ricœur, souffrir c’est « persévérer dans le désir d’être et dans l’effort pour exister en dépit de… » (Ricœur, 1994).
« La perception de la souffrance dans la relation avec le patient implique l’accentuation de la singularité de sa présence, de son individualité, en tant aussi qu’elle est corporelle. » (Queneau, Ostermann, 2000.) Ce respect de l’autre, de sa douleur, puis de sa souffrance, ouvrira les portes de l’intersubjectivité. Passé la sidération, l’effraction et l’angoisse de la sensation douloureuse, la juste distance et l’accompagnement, même silencieux, du soignant aideront le patient à se sentir à nouveau sujet. Car, j’insiste, sans subjectivité comment concevoir la relation ? La verbalisation autour de l’éprouver permettra ensuite de se le représenter et de le partager. Il me paraît peu pertinent, en revanche, pour le psychologue, de chercher à décrire ou à expliquer la physiologie de la douleur. Il vaut mieux laisser les médecins le faire. La prise en charge psychologique n’a pas de visée antalgique à proprement parler, mais une visée d’étayage de l’individu dans son intégrité et sa singularité. Travailler la subjectivation, c’est aboutir à faire des liens entre les affects et l’histoire personnelle du malade. Toutefois, il faut dire que ce travail s’envisage plus aisément avec les patients douloureux chroniques.
Douleur chronique : un biais vers la relation
De nombreuses évidences semblent nous expliquer en quoi et pourquoi l’élaboration et la communication sont plus aisées avec les malades chroniques. En revanche, je n’analyserai ce phénomène que sous l’angle qui nous occupe ici, celui de l’intersubjectivité.
Il n’est pas rare que la récurrence ou la persistance de douleurs aiguës fasse le lit de douleurs chroniques. D’autres mécanismes peuvent ainsi entrer en jeu dans la chronicisation et la souffrance morale en fait partie. Comme le confirme De Muylder : « Par sa persistance et par son imprégnation de toutes les composantes de la personnalité, la douleur chronique entame l’élan vital, annihile la joie de vivre et donc, tôt ou tard, le tableau clinique laisse apparaître les signes de dépression. À ce stade-ci, la douleur devient aussi souffrance. » Ainsi, la rencontre soignant-soigné puis la prise en charge s’entament et s’envisagent différemment. L’une des différences tiendrait au fait que la douleur chronique, véritable maladie en soi, ouvrirait à un certain nombre de patients un appétit relationnel plus évident que dans les cas de douleurs aiguës, qui, on l’a vu, les en vidaient au contraire.
Si une relation privilégiée est recherchée par le biais des douleurs chroniques, il faut toutefois préciser qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle relation. « La persistance de ces douleurs et l’incapacité fonctionnelle qui en découle provoquent de sérieuses perturbations de toutes les relations humaines. Ainsi le rôle et la place du patient dans la famille, les relations extérieures et la société se modifient sensiblement. » (De Muylder, 2003.) Il semble donc que cet appétit relationnel dont je parlais soit en fait dévié de sa trajectoire habituelle.
La douleur affecte notre rapport aux autres et à nous-mêmes. En effet, les liens que le patient douloureux entretiendrait à lui-même seraient teintés de la même focalisation algique que dans le cadre des douleurs aiguës. Ainsi, le surinvestissement narcissique réagissant au vécu algique lancinant altèrerait plus ou moins fortement ses relations à son environnement ainsi que ses activités de la vie quotidienne. Ces sujets se replient et se disent souvent incompris par les autres. Fuyant les jugements et la culpabilité de n’être plus ceux qu’ils étaient avant, ils se vivent à la fois bourreau et victime des autres. La douleur isole, on l’a vu. Or, plus on est seul, plus elle semble difficile à supporter. Le sentiment de solitude se renforce, les symptômes persistent et la souffrance s’installe. Comme la préoccupation douloureuse les vide de nombreux intérêts et plaisirs, ils voient alors chez tous les spécialistes qu’ils viennent à consulter la possibilité d’être enfin entendus par « les seules personnes pouvant les comprendre » et de retrouver l’espoir d’un mieux-être.
Des pièges dans la relation soignant-soigné
Cette relation aux soignants est malheureusement pleine d’écueils. En effet, le patient noue souvent un lien interpersonnel trop asymétrique dans lequel le médecin est érigé au rang de « tout-puissant. » Au lieu d’étayer et de contenir la plainte, ce dernier succombe souvent à la tentation des examens complémentaires. Ce faisant, il satisfait à des demandes manifestes généralement répétées, mais aussi à des désirs latents mutuels. Or, ce recours défensif à l’agir tendrait à entretenir le mécanisme et l’économie des symptômes douloureux. Comme l’écrit Queneau : « Le refus du dialogue est l’impasse relationnelle par excellence. » (Queneau et coll., 2001.) Aussi satisfaisantes et rassurantes qu’elles soient dans un premier temps, on se rend compte combien ce genre de relations rend l’autre dépendant et passif. C’est ainsi qu’elles contribueraient au processus délétère de la chronicisation.
La régression, assez courante chez les patients douloureux, est un piège que le psychologue doit essayer d’éviter. En effet, l’objectif est de ramener le sujet au centre de sa vie ; vie dont il redeviendra l’acteur, et ce, malgré les douleurs. La communication intersubjective et l’interprétation de cette communication sont un moyen d’atteindre cet objectif. Si l’enjeu de la maladie douloureuse relève de la problématique relationnelle, il s’agirait d’abord, pour qu’elle soit thérapeutique, d’accepter que la relation au soigné devienne certes une alliance, mais, avant tout, une relation humaine à part entière. Toujours d’après Queneau, une douleur soulagée serait toujours le « fruit d’une participation active au sein d’une relation » (Queneau et coll., 2001).
Les enjeux relationnels dans la prise en charge psychologique
À l’intérieur des consultations psychothérapeutiques, une majorité de personnes arrivent (souvent adressées par le médecin) pour des douleurs inexpliquées ou une souffrance « disproportionnée » par rapport aux douleurs médicalement objectives. Il n’est pas rare, alors, d’y voir ces personnes déposer les bagages d’une histoire personnelle (plus exactement de celle de leurs douleurs), alourdie par la répétition et la succession de rejets, d’abandons et d’échecs de la part des « spécialistes » qu’ils ont pu consulter auparavant. Si la maladie douloureuse semble comme chercher et offrir l’occasion d’un lien intersubjectif, cette recherche « éperdue » est source d’espoirs comme source d’illusions. Elle révèle toutefois l’un des objectifs principaux dans la démarche de ces malades : l’écoute et le respect de la plainte, de la souffrance ; parfois même avant le traitement de la douleur. Au fil des entretiens, leur discours en vient rapidement à tourner autour des affects et du vécu quotidien, reléguant par là même le somatique au second rang. « La douleur est bien plus qu’un symptôme, elle est à la fois un comportement et un langage où la composante émotionnelle peut prendre le pas sur la sensation douloureuse. » (Queneau et coll., 2001.)
Autrement dit, ces malades viennent trouver ce qu’ils n’ont pas ailleurs. Et notre travail consiste peut-être à trouver quoi. L’angoisse provoquée par l’absence d’objectivation médicale des douleurs peut être atténuée par la prise en charge psychologique. Entendre autrement ces douleurs, mieux comprendre le mal-être, même si l’objectif n’est pas de trouver « la » vérité dessus, permet de reprendre le contrôle sur elles et de se défaire de cet inquiétant sentiment d’étrangeté qu’elles engendrent. Notre travail de psychologue se perd à vouloir signifier la douleur. Au lieu de nous demander pourquoi ce patient a mal, nous devrions plutôt nous demander comment il souffre. Le fait est que l’on ne parvient pas toujours à le guérir de ses douleurs ; néanmoins, si elles le font moins souffrir, c’est déjà pas mal !
Tout comme les soignants, le « psy » n’est pas à l’abri du risque d’être considéré comme un spécialiste de plus, qui est là pour les guérir. Or, et là réside toute l’ambivalence, je ne crois pas toujours qu’il s’agisse de leur réelle demande. Les douleurs chroniques peuvent, en miroir au vécu individuel, amener au constat d’impuissance de la relation. Tout se passe comme s’il existait dans ces douleurs quelque chose qui cherchât à être entendu. Et tant que cela n’aura pas été fait, rien ne semblera pouvoir les atteindre. Finalement, inconsciemment, le patient pourrait attendre celui qui lui dira « je ne sais pas ». Par ces mots, le thérapeute viendrait humblement se mettre au niveau de l’autre et de sa subjectivité, pour qui, rappelons-le, l’appel à l’aide ressemble avant tout à un appel à la reconnaissance.
Point de réflexion théorique
Nous avons évoqué précédemment la notion de traumatisme. Les théories freudiennes nous expliquent que la douleur chronique pourrait être le résultat d’un malaise psychique intense impossible à verbaliser, qui, par le biais de la rencontre intersubjective, cherche à être entendu et reconnu. Elle pourrait aussi faire suite au traumatisme non dépassé de la douleur aiguë, qui, par effraction, aurait marqué de son empreinte l’inconscient du sujet, le destinant à revivre inlassablement les stigmates de l’expérience initiale qui avait débordé ses capacités d’élaboration psychique. Organisé autour de ses douleurs parfois depuis de nombreuses années, le patient cacherait derrière les symptômes toute une économie psychique qui semble garder jalousement le secret de leurs significations. Autrement dit, l’impossible élaboration du traumatisme provoqué par la douleur aiguë semble aussi favoriser la chronicisation. Le mécanisme et l’économie des symptômes sont tels qu’ils font écran à sa compréhension. J’ouvre une parenthèse afin de préciser que notre référence ici à la psychanalyse ne signifie pas pour autant que nous supposons une origine psychologique à la douleur. L’apport de Freud sur ce point nous aide à penser autrement les liens qui se tissent entre douleur, souffrance et intersubjectivité.
Enfin, comparée aux douleurs aiguës qui ont généralement une histoire limitée dans le temps, la maladie douloureuse, elle, se draperait de chaque partie du sujet souffrant et de son histoire. La conscience du mal-être et la nécessité psychique de l’évacuer font de ces patients des consommateurs privilégiés de « mains tendues » et potentiellement de prises en charge psychothérapeutiques. C’est ainsi qu’ils remplissent largement les consultations des centres antidouleur. Si leurs souffrances n’y sont pas non plus entendues, leur seul avantage, malheureusement, n’aura été alors que d’alléger les salles d’attentes des médecins généralistes.
Conclusion
Qu’elles soient aiguës ou chroniques, les douleurs sont aujourd’hui le porte-drapeau d’une clinique qui prend de plus en plus conscience de ses difficultés à se suffire à elle seule. La subjectivité, l’individualité, retrouvent leur place au centre des débats. Le patient douloureux nous prouve qu’il reste l’unique propriétaire de ses symptômes.
La douleur est multifactorielle. Elle peut s’envisager tout aussi légitimement du point de vue du somatique, du psychologique, du social ou encore du spirituel. Ici, j’ai choisi de la confronter aux mécanismes et aux enjeux de l’intersubjectivité. Que deviennent la relation, la communication et la place de l’autre à l’intérieur de l’expérience douloureuse ? La douleur interroge le relationnel, tout comme il l’interroge en retour. Certains patients notamment nous montrent combien la problématique de leurs douleurs renvoie inlassablement à une problématique de l’altérité. Sans verser dans l’excès d’un « tout relationnel » tout-puissant et absolutiste, j’ai voulu montrer ici que l’intersubjectivité à l’épreuve de la douleur pouvait tantôt être un biais, un enjeu ou un moyen. De même, l’Autre pourrait bien être le facteur, voire le vecteur de l’existence, de l’entretien ou de l’amélioration des symptômes.
« La douleur-symptôme qu’il faut comprendre et traiter est également une douleur-relation qu’il conviendrait de ne pas occulter derrière des techniques de plus en plus efficaces, mais qui ne remplaceront jamais la parole ou la présence de l’Autre, le semblable. » (Moutel et coll., 2003.) Aussi, c’est parfois à nous, psychologues, que revient le rôle d’incarner cet Autre, et, par notre présence, notre étayage, notre analyse, de faire du lien interpersonnel la voie d’accès à la souffrance et le véhicule de son apaisement. ■