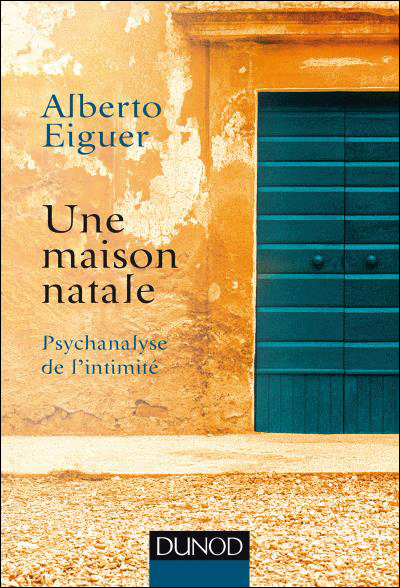Dossier : journal des psychologues n°242
Auteur(s) : Scharnitzky Patrick, Tapia Claude
Présentation
L’auteur en s’appuyant sur de très nombreuses enquêtes et expérimentations démonte certains des processus mentaux à l’origine de faits courants de discrimination. Il souligne l’effet des « prophéties autoréalisatrices sur les comportements, notamment dans les domaines de l’éducation, du recrutement… et sur les relations interindividuelles ou intergroupes ; mais formule des réserves sur les résultats d’une éventuelle politique de discrimination positive. En tout état de cause, la discrimination représenterait un moyen de lutte contre nos angoisses identitaires.
Mots Clés
Détail de l'article
Claude Tapia Dans le registre de la psychologie sociale, de nombreux travaux (articles et ouvrages) sont parus ces dernières années sur le thème de la discrimination, du racisme, du sexisme, des conflits interethniques, etc., sans doute parce que notre société multiculturelle y est de plus en plus sensible et que le domaine des relations intergroupes et des mécanismes psychologiques afférents occupe une place centrale dans l’éventail des recherches psychosociologiques. Votre ouvrage sur « les pièges de la discrimination » décortique, de manière indubitablement pédagogique, en s’appuyant sur de très nombreuses expérimentations et exemples, certains des processus mentaux à l’origine des faits de discrimination les plus connus du grand public. Pouvez-vous, pour commencer, décrire la chaîne des opérations conscientes ou inconscientes qui interviennent dans la construction des attitudes et des comportements discriminatoires et dans la transmission intergénérationnelle de ceux-ci ? Vous avez sans doute raison de présenter dans votre ouvrage, pour les opposer ou les rendre complémentaires, le courant environnementaliste ou contextualiste (prolongeant les thèses de Milgram) et le courant psychodynamique (issu des travaux d’Adorno) et de montrer leur lien avec les développements de la théorie de l’identité sociale et ceux de la théorie des représentations sociales.
Patrick Scharnitzky Le champ des relations intergroupes occupe depuis cinquante ans une place prépondérante dans la recherche en psychologie sociale. L’intérêt particulier à mes yeux est, en effet, la complémentarité entre des approches dites « socioculturelles » et des analyses davantage centrées sur le fonctionnement psychologique des individus, qu’il soit clinique ou sociocognitif. Pour synthétiser, on pourrait dire qu’il existe chez tout être humain une prédisposition « naturelle » à discriminer, et que celle-ci est particulièrement « stimulée » dans des contextes sociaux propices aux conflits et à l’affrontement entre les groupes.
La chaîne des opérations menant aux attitudes discriminatoires trouve probablement sa source dans le fonctionnement cognitif avec le principe de la catégorisation sociale. Par souci d’économie mentale, l’être humain, que certains chercheurs qualifient « d’avare cognitif », cherche à traiter toute information de façon rapide et économique, par le biais de la catégorisation. En découle le stéréotype qui est aujourd’hui défini comme le « simple » contenu des informations associées à chaque catégorie sociale. Si le stéréotype n’est pas du tout utilisé dans les interactions sociales (ce qui est un cas d’école mais concrètement impossible), il n’est en rien malveillant. À l’inverse, quand le stéréotype devient évaluatif, c’est-à-dire une source d’information pertinente dans les interactions sociales, on dira qu’il s’agit d’un préjugé. Enfin, l’acte verbal ou comportemental envers un individu, appartenant à un groupe différent du nôtre et qui peut découler de ce préjugé, caractérise une attitude discriminatoire.
Le contexte social intervient à deux niveaux. D’une part, il peut jouer un rôle de catalyseur dans la mécanique discriminatoire. Les situations de crise économique, de conflit politique, d’affrontement communautaire, ont pour fâcheuse conséquence d’accroître les tensions et les frustrations individuelles, ce qui pousse les individus à entrer en conflit avec « l’autre » qui est toujours perçu comme la cause évidente de son mal-être. D’autre part, le contexte social joue en effet un rôle important de transmission. Les stéréotypes sont transmis de génération en génération par l’éducation, l’école et l’ensemble des médias qui ne se gênent guère pour les exploiter. La publicité est un exemple frappant et accablant de la façon dont les individus sont mis en scène et utilisés à des fins commerciales en fonction de leurs genre, nationalité, âge ou encore caractéristiques physiques.
C. T. Une série d’expériences de laboratoire que vous citez traitent des effets de ce qu’on appelle « prophéties autoréalisatrices » démontrant l’efficacité des stéréotypes et préjugés dans différents domaines – par exemple celui des performances scolaires (cf. effet Pygmalion), celui du recrutement, etc., débouchant sur des formes diverses de stigmatisation involontaires ou inconscientes. Concrètement, les sujets d’une expérimentation, comme les individus dans la vie sociale, se conforment, dans une certaine mesure, aux croyances et projections des attentes d’un agent dominant ou d’une institution sociale majeure. Le degré de généralité ou d’universalité de cette tendance, vous avez raison de le souligner, peut décliner dans des circonstances où les détenteurs d’autorité ou de légitimité manifestent des défaillances ou quand les individus concernés par des projections ou des jugements négatifs contestent – par originalité ou anticonformisme – la source de l’évaluation. Quelle leçon peut-on tirer, à votre avis, de ces travaux, dans l’optique de l’élaboration d’une politique de discrimination positive menée actuellement dans diverses sociétés démocratiques à l’égard de populations défavorisées ?
P. S. Les travaux que vous évoquez s’inscrivent dans un courant de recherche passionnant sous le concept de la menace du stéréotype (voir Croizet et Leyens, 2003). Penser qu’un individu puisse se conformer au stéréotype envers son groupe au lieu de chercher à le contredire est certainement le mécanisme psychologique dans ce domaine à la fois le plus pervers et le plus contre-intuitif. Pourtant, un grand nombre d’expériences en font la démonstration dans des domaines tels que le recrutement ou l’acquisition de compétences scolaires.
La première des leçons est probablement de chercher à former les publics en charge de formation, quelle qu’elle soit, pour les mettre en garde contre cette forme de « pouvoir » implicite dont ils disposent et dont ils pourraient abuser involontairement. En ce qui concerne le débat sur la discrimination positive, la leçon est déjà plus compliquée à tirer. Vous avez raison de faire cette analyse, car, si une politique de discrimination positive pouvait faire naître chez des publics habituellement stigmatisés le sentiment de compétence et de reconnaissance, on pourrait faire l’hypothèse légitime d’un scénario positif. Toute la question est de savoir si un individu, bénéficiant officiellement et publiquement d’une faveur sur le principe de la discrimination positive, serait en mesure de faire ce travail psychologique d’un « autorenforcement » narcissique ? Je n’ai pas la réponse, mais on peut émettre une réserve.
La seule recherche francophone qui met en scène une situation de discrimination positive (Lorenzi-Cioldi et Buschini, 2005) montre que plus le principe de favoritisme positif dont bénéficie une pseudo-candidate pour un poste est fort, plus elle est perçue en conformité avec le stéréotype préexistant envers les femmes. Les auteurs posent donc la question suivante : « Vaut-il mieux être une femme qualifiée ou être qualifiée de femme ? » Il semble que la discrimination positive ne puisse pas créer un effet Pygmalion, car la personne qui en bénéficie n’est pas dupe, à la différence de l’écolier par exemple.
Je peux concevoir la volonté politique et citoyenne réelle existant chez certains partisans de la discrimination positive (par exemple Kesslassy, 2004) ainsi que le bénéfice socio-économique immédiat pour certains « exclus », mais j’ai des doutes plus profonds quant aux effets possibles de cette mesure sur l’état psychologique et l’identité des bénéficiaires et plus largement sur le changement des mentalités et la réduction des croyances préjudiciables envers ces « exclus ».
C. T. Un chapitre de votre ouvrage aborde le problème du lien entre discrimination et angoisse, l’une des hypothèses étant que la première agit en quelque sorte comme mécanisme de défense contre le mal ou le malheur incarné par des individus ou des groupes sur lesquels s’opère – selon les psychanalystes de l’école anglaise (Mélanie Klein et Elliott Jacques) – la projection de pulsions destructrices. La seconde, fondée sur les théories de l’équilibre, propose de considérer la discrimination comme un outil de rationalisation, de mise en cohérence de l’état des croyances et représentations et celui de la réalité objective environnante. Enfin, la dernière évoquant la théorie de l’engagement établit un lien entre l’engagement social, la radicalisation des opinions (par répétition des actes correspondants) et la tendance à la multiplication des comportements discriminatoires. Comment, dans votre propos, s’articuleraient ces différentes théorisations ?
P. S. Je dois dire que c’est le thème sur lequel je me suis autorisé le plus de liberté dans le livre en abordant cette problématique. La relation entre angoisse et discrimination est intense. Les trois courants que vous citez ont le point commun de présenter la discrimination comme pouvant être un outil. Et je partage pleinement ce point de vue. La discrimination peut fonctionner comme un pare-feu très efficace contre l’angoisse qui peut être incarnée par l’autre. Discriminer remplit, à mes yeux, au moins deux fonctions à ce niveau.
D’une part, c’est effectivement une façon de rationaliser une réalité, de la rendre cohérente avec nos croyances et nos valeurs. On parle de « la peur de se tromper », car se tromper et surtout l’admettre, c’est remettre en cause toute une série de positions et de raisonnements, ce qui est une atteinte indéniable à notre narcissisme. La théorie de l’engagement l’a d’ailleurs montré brillamment. La discrimination apparaît donc comme un bon moyen non pas de ne pas se tromper, mais de maintenir en l’état des équilibres qui nous ont été transmis et auxquels nous sommes attachés.
D’autre part, discriminer permet d’affirmer une position sociale. Notre identité n’est définie que par un enchevêtrement de groupes sociaux auxquels nous appartenons et auxquels nous nous identifions. Comme l’a montré Henri Tajfel (1978), le seul moyen de maintenir cette identité sociale à un niveau satisfaisant, c’est de se persuader que nos groupes d’appartenance sont les « meilleurs » et la discrimination est le meilleur moyen d’y parvenir. La discrimination est donc aussi un formidable moyen de lutter contre nos angoisses identitaires.
C. T. Je trouve tout à fait pertinent, s’agissant de l’analyse des facteurs accroissant ou réduisant les discriminations, d’avoir évoqué celui de la proximité physique, de la cohabitation, du partage d’espaces sociaux, etc. Il est vrai que le sens commun – comme d’ailleurs divers travaux de psychologie sociale américaine (voir Allport, 1954) – tente de faire croire à l’effet bénéfique des contacts interethniques ou interculturels. La réalité, de nombreuses enquêtes et expérimentations le montrent clairement (voir : Tapia 1972 et Drozda-Senkowska, 1997), est que la proximité, la ressemblance avec les autres, loin de favoriser l’établissement de sentiments positifs ou favorables, le contrarient ; cela parce que l’accentuation des ressemblances et des différences avec les autres constitue une menace identitaire à laquelle les individus réagissent. Vous référant à Hewstone et Brown (sur les conditions d’interactions positives), votre conclusion évoquant l’écart entre le préjugé et le passage à l’acte paraît plutôt optimiste sur le problème de la mixité sociale. Comment justifier concrètement votre conviction ?
P. S. Les travaux sur les contacts intergroupes ont effectivement donné des résultats décevants, car les auteurs (comme par exemple Hewstone et Brown (1986), mais ce ne sont pas les seuls) se « contentent » d’établir une liste de conditions dans lesquelles le contact pourrait être bénéfique. En outre, ces conditions sont souvent totalement irréalistes et tautologiques. On nous explique par exemple que, pour qu’un contact soit positif, il ne faut pas que les stéréotypes préexistant à la rencontre soient trop forts ! Mais alors à quoi pourrait bien servir ce contact ? Pis, des travaux plus récents encore montrent que, dans certains cas, le contact avec un exogroupe accroît le degré de confiance en soi dans les opinions et peut accentuer la rigidité du stéréotype négatif.
Cependant, je conserve un point de vue optimiste, car la mixité sociale dont nous rêvons tous n’existe pas et les différents modèles qui nous ont été proposés dans la réalité sociale n’ont jamais permis un réel mélange. Si la mixité sociale ne fonctionne pas, ce n’est, selon moi, pas seulement un problème identitaire. C’est surtout qu’elle n’est quasiment jamais volontaire et intégrale.
Par exemple, la Loi SRU impose aux villes de plus de 10 000 habitants un taux d’équipement de 20 % au minimum de logements sociaux. La Seine-Saint-Denis est en moyenne à 38 % quand les logements sociaux représentent moins de 1 % du parc immobilier d’une ville comme Neuilly-sur-Seine. Comment parler dans un cas comme dans l’autre de mixité sociale ? Elle est subie dans le premier cas et rejetée dans le second. En outre, elle donne lieu à un racisme différent mais bien réel. Le vote frontiste est quasiment aussi fort dans les régions à forte condensation d’étrangers et dans les régions où ils sont quasiment absents. On comprend donc bien que, le problème, c’est soit trop de contact subi qui donne un racisme ancré dans le rejet du quotidien, soit trop peu de contact qui donne un racisme fantasmé mais tout aussi fort.
Le problème de la généralisation de la mixité sociale est au cœur du problème. Pour qu’elle fonctionne, elle doit être intégrale, c’est-à-dire au niveau des écoles, des logements, les entreprises, des lieux d’activité culturelle et sportive, etc. Les travaux aux États-Unis sur le contact intergroupe montraient très bien cette question de généralisation. Un ouvrier blanc pouvait admettre que son collègue noir était sympathique et compétent, il refusait cependant qu’il habitât sur son palier ou que leurs enfants partagent les mêmes bancs d’école. Je constate donc logiquement que la mixité telle qu’elle existe ne fonctionne pas, mais je continue à croire en ses vertus.
C. T. Je pense, comme vous l’écrivez, qu’il faut aider les gens à résister aux menaces qui planent sur leurs attitudes face à autrui, autrement dit à la tendance à la discrimination, parmi lesquelles vous citez la fatigue physique et la surcharge cognitive (d’où le recours aux stéréotypes), le sentiment d’absence de contrôle sur nos actes (d’où l’affaiblissement du degré d’élaboration cognitive), le poids des émotions sur nos perceptions et jugements. Pour ne retenir que le dernier point, les recherches de Bernard Rimé sur « le partage social des émotions » montrent que, loin de biaiser les communications sociales, l’émotion remplit des fonctions régulatrices, intervient comme facteur de facilitation et de stimulation des interactions sociales et au-delà comme facteur d’intégration sociale. Certes, l’objectif et le registre de votre recherche sont différents de ceux de Rimé, mais comment concevoir dans votre optique que les émotions soient source de discrimination et d’appel aux stéréotypes et en même temps instrument d’adaptation et de partage social ?
P. S. Je ne suis pas un grand spécialiste de la théorie du partage social des émotions de B. Rimé (2006), mais je pense que nos propos ne sont pas contradictoires, loin de là. La théorie de B. Rimé met en évidence les effets bénéfiques à communiquer et à partager des émotions communes (voir le n° 240 du Journal des psychologues de septembre 2006 sur « Le partage social des émotions »). C’est donc le contenu de l’émotion qui est un vecteur de rapprochement et donc de partage social. Dans le champ des travaux que je cite, il s’agit de recherches sur l’effet des émotions sur le jugement social (voir Niedenthal, Krauth-Gruber et Ric, 2006). Il est démontré depuis longtemps en cognition sociale que les émotions peuvent « dénaturer » la réalité et biaiser la qualité des informations qui sont perçues. L’émotion est donc analysée non pas du point de vue de son contenu, mais du point de vue des conséquences de son intensité sur l’activité cognitive. Ce qui est intéressant ici est de savoir comment la joie, la tristesse ou la colère peuvent donner un sens différent à la réalité dans laquelle nous évoluons quotidiennement.
En outre, ces travaux portent quasiment toujours sur des situations intergroupes et sur la façon dont les émotions intenses peuvent biaiser la nature des jugements sociaux exprimés à l’égard de membres d’exogroupe. On apprend comment les stéréotypes peuvent être plus ou moins utilisés dans les jugements sociaux en fonction de l’intensité de l’émotion que ressent celui qui est dans la position de se former une impression d’une personne ou d’un groupe dans son ensemble. De son côté, la théorie du partage social des émotions s’applique particulièrement à des situations de communication au sein d’un groupe social ou d’une communauté culturelle.
On peut donc tout à fait concevoir que l’émotion soit à la fois une source de communication et de partage et qu’elle puisse, d’un point de vue cognitif, parasiter la nature de nos interactions avec autrui.
C. T. Le dernier point que je souhaiterais vous voir aborder concerne, dans une perspective globalisante et synthétique, l’utilité sociale de votre œuvre, à laquelle je crois. La vaste documentation sur laquelle vous vous êtes appuyé vous suggère sans doute des propositions quant aux moyens et aux voies de contrôle, de canalisation des passions destructrices inhérentes aux rapports humains et sociaux.
P. S. C’est très flatteur pour moi d’entendre parler d’utilité sociale à propos de ce livre. L’objectif est en effet de mettre à la portée de quiconque des recherches en psychologie sociale qui pointent du doigt des dysfonctionnements que nous pouvons partiellement corriger au quotidien. À travers des exemples familiers mettant en scène des situations de discrimination et la présentation simple de recherches qui les expliquent, l’objectif est de permettre au lecteur de prendre du recul par rapport à son propre comportement. Je crois profondément que le premier travail à faire, face aux préjugés et à toutes les formes d’exclusion, est une prise de conscience individuelle de la façon dont la discrimination n’est pas le « privilège » de certaines personnes que nous pourrions identifier et dont nous pouvons nous prétendre tout à fait différents. La mécanique cognitive de la discrimination est tellement automatique qu’elle peut nous piéger « à notre insu ». Je souhaite juste que ce livre puisse permettre à certains de le réaliser et de l’accepter afin, peut-être, de corriger certaines attitudes.
La vulgarisation scientifique est une démarche difficile et qui n’est pas toujours bien perçue par notre communauté, mais elle est au cœur de notre activité. L’utilité sociale de la recherche en médecine va de soi. Elle n’a pas de sens si « elle ne sert à rien ». Il devrait, selon moi, en être de même pour la recherche en sciences sociales. ■
BibliographieAllport G., 1954, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley, Cambridge. |